« L’image, l’image, l’image »
Entretien avec Catherine Cadou, traductrice de films japonais
Depuis 1984, Catherine Cadou traduit la plupart des films japonais distribués en France. Sous-titreuse fidèle d’Akira Kurosawa et de Shôhei Imamura avec lesquels elle a collaboré étroitement, elle se fait aussi passeuse du cinéma d’aujourd’hui en traduisant notamment les films d’Hayao Miyazaki, d’Hirokazu Kore-eda et de Naomi Kawase.
Dans ce riche entretien au ton direct et enlevé, elle évoque sa proximité avec les grandes figures du cinéma japonais et livre sa conception de la traduction cinématographique.
Nous avons adopté pour les noms de personnes l’usage occidental (prénom suivi du nom de famille) et non l’usage japonais.
Au commencement
Avez-vous toujours traduit pour le cinéma ?
Non, j’ai d’abord été interprète de conférence. J’adore le passage d’une langue à l’autre. Je traduisais les présidents de la République, mais aussi des ingénieurs et des commerciaux dans les domaines techniques, notamment au sujet du nucléaire car j’étais anti-nucléaire. J’étais très forte en nucléaire. Dans les années 1970-1975, on a fait des procès contre EDF et on les a gagnés, mais EDF n’en a pas tenu compte. C’était révoltant, et j’ai décidé de faire quelque chose à mon petit niveau, auprès des journalistes et décideurs locaux qui venaient en voyage tous frais payés par les électriciens japonais. Ils me disaient : « C’est formidable, le consensus nucléaire en France !» Et je leur répondais : « Non, tout le monde n’est pas pour ! » Je dénonçais vigoureusement le retraitement des combustibles irradiés.
Étiez-vous très cinéphile ?
Non, pas spécialement. J’avais traduit, une fois, en 1972, une rencontre entre Shinsuke Ogawa et Joris Ivens, deux maîtres du cinéma documentaire. Et c’était complètement passionnant. J’adorais le rapport aux cinéastes plutôt qu’au cinéma, d’ailleurs. Je suis vraiment entrée dans ce milieu par la langue.
Connaissiez-vous bien le cinéma japonais à cette époque ?
J’avais vu tous les Kurosawa qui étaient sortis, j’avais vu des Ozu et à peu près tous les films japonais sortis en France. À cause de la langue japonaise, sans doute. Mais je n’étais pas spécialement cinéphile, dans le sens où je ne connaissais pas la grammaire du cinéma. Mais j’étais très bonne traductrice, interprète, et j’ai été sélectionnée (oui, oui, après une entrevue avec les responsables de la Fox, à Paris) en 1980 pour traduire pour Akira Kurosawa, au festival de Cannes.
Pour quel film ?
Kagemusha [1980]. Il était déjà sous-titré, mais je devais traduire la conférence de presse et les interviews.
Savez-vous qui traduisait avant vous ?
Kagemusha, c’était Jean Campignon, un bon copain qui est mort maintenant. C’était un des pionniers, il traduisait beaucoup au Japon. Il était absolument génial. Kagemusha, ça a été vraiment le baptême du feu pour moi. Il y a eu une controverse sur les sous-titres de ce film parce que Campignon, qui traduisait comme il respirait, ne contrôlait pas son vocabulaire. Dans Kagemusha, il y avait des injures du genre « cornichon vert ! » Par contre, il parlait du « seigneur qui chevauchait la concubine ». Moi, je trouvais ça très bien, c’était du vocabulaire imagé et choisi de Kurosawa, c’était la première fois que je voyais un film qui respirait le texte original. Mais il y a eu une controverse à Cannes parce que les japonisants qui avaient pignon sur rue et veillaient à une présentation normalisée du cinéma japonais ont dit : « Kurosawa ne parle pas comme ça. C’est beaucoup trop cru ! » Moi qui étais interprète et pas sous-titreuse, j’ai pris sa défense. Et je me suis dit : « Je ne ferai jamais de sous-titres ! »
Qui n’aimait pas ces sous-titres-là ?
Des gens qui censuraient. Les Japonais eux-mêmes ont beaucoup censuré, canalisé… Ils jugeaient que les Occidentaux ne pourraient pas comprendre.
Les distributeurs aussi ?
Un peu la distribution. Mais surtout les Japonais.
Certains distributeurs racontent que lorsqu’ils tentaient d’obtenir des films japonais, on leur disait : « Non. Pourquoi ces films vous intéressent-ils ? Ils ne sont pas pour les Occidentaux. » Est-ce vrai ?
Absolument. Rashômon [1950] a été programmé à Venise à l’insu de Kurosawa, parce qu’une Italienne avait vu le film et avait dit : « Il faut le présenter à Venise ». Les producteurs japonais avaient répondu : « Ce film n’a aucun intérêt, les Occidentaux ne vont rien comprendre. » Quand Kurosawa a appris qu’il avait le Lion d’or, il a dit : « Quoi ? Qu’est-ce que c’est, ce festival ? » Il n’avait, lui-même, pas pensé une seconde que son film pouvait plaire à des étrangers.
Il y a donc eu cette controverse avec Kagemusha. À la sortie du film, Michel Mardore, qui écrivait dans Le Nouvel Observateur, a soulevé le problème1, car les sous-titres avaient été refaits après Cannes, mais pas par moi. Mardore a posé la question à Kurosawa : « Mais qu’est-ce qui s’est passé avec les sous-titres ? Il me semble que ceux de Cannes étaient mieux. » C’est le seul qui a osé le dire. Comme j’étais l’interprète pour l’entretien, je l’ai félicité : « Bravo, vous avez complètement raison, ils étaient dix fois mieux. » Peut-être qu’on aurait pu enlever « cornichon vert ». Mais « chevaucher la concubine », là, je suis d’accord. Les expressions imagées, absolument d’accord, parce que c’est bien Kurosawa.
Kurosawa savait-il qu’il y avait une différence entre les deux sous-titrages ?
Non, il l’a appris à l’occasion de cet entretien. Il a été très marqué par cette histoire. C’est peut-être pour ça qu’après, il m’a demandé de traduire Ran. Peut-être parce qu’il s’est dit : « Elle, elle sera dans le bain. » J’avais passé trois ans à l’assister dans ses négociations avec Daniel Toscan du Plantier2, à Venise, à Paris, avec Jack Lang, puis avec Serge Silberman. C’est ainsi que Ran est devenu la première coproduction franco-japonaise. En outre, j’ai vu ce qu’il voulait faire pour ce film, car j’ai passé beaucoup de temps sur le tournage. J’ai, en particulier, passé les trois semaines du tournage du film AK de Chris Marker sur place, au pied du mont Fuji. Cette idée de making-of était une idée du producteur français Serge Silberman. Mais Kurosawa ne connaissait pas Chris Marker. Le producteur japonais, affolé, m’a appelée au mois de juillet [1984] : « Est-ce que vous pouvez venir dans trois jours ? Chris Marker vient rencontrer Kurosawa et il faut que cela se passe bien. » Moi, j’étais en France ; j’ai dit d’accord et j’y suis allée. J’ai expliqué à Kurosawa qui était Chris Marker. Je ne le connaissais pas personnellement, je n’avais vu que La Jetée [1963]. Chris est arrivé le lendemain. Ils étaient tous les deux assez… Pas timides, mais réservés, disons. Chris était quelqu’un qui parlait… Comme si on lui arrachait les mots. Avec des phrases toutes sibyllines, mais très fortes. En face de Kurosawa, il était, en plus, légèrement intimidé. Donc, ce n’était pas facile.
Il ne parlait pas japonais ?
Pas du tout. Il connaissait la musique de la langue, il avait réalisé d’autres projets sur le Japon et aimait beaucoup ce pays3. En définitive, ça s’est bien passé et j’ai ensuite passé trois semaines sur le tournage. Kurosawa a accepté tout de suite en disant : « D’accord, à deux conditions. Mon fils sera le coordinateur du projet et Catherine, l’interprète. Si Catherine est là, il n’y a pas de souci. » Comme j’étais tout le temps sur le tournage, un jour, je lui ai dit : « J’aimerais bien être figurante. Avec un casque, je serai invisible. Je monte à cheval, vous savez. » Il a eu l’air surpris et a souri : « Si tu veux. Je peux te présenter à l’assistant qui recrute les figurants. » Ensuite, quand j’ai vu les batailles, je n’ai pas voulu prendre le risque, en tombant de cheval, de gâcher une scène qui valait des millions.
C’est comme ça que Kurosawa a pensé à moi plus tard, qu’il m’a créé un rôle dans Rêves, son film suivant. C’était adorable, ça avait cheminé dans sa tête. J’avais traduit le scénario de l’épisode « Les Corbeaux », le rêve où il rencontre Van Gogh, parce qu’on avait pressenti un acteur français. Entre-temps, Kurosawa a changé d’idée et pensé à Martin Scorsese. J’avais donc traduit le scénario en français et il m’a alors déclaré que je jouerais le rôle de la lavandière, avec des dialogues !
Ran est donc le tout premier film que vous avez sous-titré ?
Oui, officiellement. En fait, c’était juste après AK, sur lequel j’ai appris le métier. Mais je n’ai pas signé AK car ce sous-titrage a été une œuvre collective qui n’a jamais été signée. Je ne suis pas la seule auteure des sous-titres. Je me suis largement basée sur les projets de sous-titres de Chris. Pour le montage, il avait été aidé par une Japonaise, Yuko Fukusaki, qui figure au générique sous la rubrique « Regard japonais ». Elle est d’ailleurs également devenue interprète, mais ne fait pas de sous-titres. Et puis, j’ai travaillé avec Hiroko Govaers4 qui était la principale sous-titreuse de films japonais en France avant Ran. Mais Chris m’avait confié la responsabilité finale en son absence (il était parti à Okinawa pour un tournage).
C’est à ce moment-là que les producteurs français m’ont demandé de faire les sous-titres de Ran. Kurosawa était d’accord car il avait confiance en moi et je savais la recherche qu’il avait faite sur la langue pour ce film. Je me suis efforcée de coller à cette langue, même si c’était un petit peu exotique.
Kurosawa s’est beaucoup intéressé aux sous-titres, parce qu’il découvrait avec moi ce qu’était une langue étrangère. Il était né à l’époque Meiji, un temps où il n’y avait pas d’étrangers. Il ne savait pas comment une autre langue pouvait fonctionner, même s’il avait lu Tolstoï, Dostoïevski et beaucoup d’autres. Mais il avait tout lu en japonais. Comme il ignorait comment ça fonctionnait, je lui expliquais et il adorait ça. Surtout, il a compris que la traduction était extrêmement importante, parce qu’elle permettait beaucoup plus de communication, d’abord dans mon travail d’interprète, puis pour ses films. Il s’est aperçu que les gens riaient au bon endroit, ce qui n’était peut-être pas le cas auparavant, et il a adoré. Il était comme un gamin.
Je me rappelle que, pour la présentation officielle de Kagemusha à Paris, il a prétendu être malade parce qu’il ne voulait pas y aller. Avec ma complicité, l’attachée de presse lui propose de venir simplement au début et de partir ensuite dans le noir. Il vient, on s’assoit tout au bord de la rangée et, au bout de cinq minutes, je lui dis : « On s’en va ? » Il me répond : « Ah non ! c’est intéressant. » Au bout d’un quart d’heure, je lui redis : « Vous voulez partir ? – Oh, tais-toi, tu m’embêtes ! » En fait, il était captivé par ses propres films projetés devant des publics étrangers. Et pour la projection parisienne de Ran sur un écran géant monté devant le Centre Pompidou, il ne s’est pas fait prier pour venir savourer son film sous-titré à son goût.
Mais il ne comprenait pas les sous-titres. Ce qu’il arrivait à percevoir, c’était le rythme ?
Il aimait le rythme, il voyait l’arrivée des sous-titres, il voyait que les gens réagissaient comme il l’avait voulu. C’était magnifique. Et ça m’a motivée pour continuer : « Si ça fait autant plaisir à Kurosawa, on va continuer. » Après, j’ai traduit deux autres films, un Oshima ancien (L’Enterrement du soleil [Taiyo no hakaba] 1960) et une comédie (Tampopo, Juzô Itami, 1985) et j’ai compris que j’étais fichue : « Le virus a frappé ! » C’est vrai que j’ai eu beaucoup de chance.
Faisons un flash-back : vous avez fait des études de japonais ? Avec l’optique de travailler comme interprète-traductrice ?
J’ai étudié les sciences économiques et j’ai fait du japonais à Langues O’ (devenue INALCO) pour m’amuser. J’ai été ensorcelée par cette langue qui est construite complètement à l’inverse du français. C’est l’ambiguïté qui domine tout. Il n’y a pas de liens logiques dans les phrases, ce ne sont que des énoncés qui coexistent ; le lien logique, c’est nous qui l’établissons.
Il n’y a pas d’articles, par exemple ?
Pas d’articles, pas de pluriel, pas de singulier. La conjugaison des verbes est très simple : il y a le présent et le passé. Il n’y a même pas de futur, puisque le futur n’existe pas, c’est le « suppositif ». En français, on est obligé de dire : « Demain, il fera beau. » En japonais, c’est : « Demain, il devient peut-être beau (ashita o tenki naru deshô). » Il n’y a que présent et passé. On joue donc avec très peu d’éléments. Par contre, les mots ont une amplitude beaucoup plus grande que les nôtres.
J’ai adoré cette langue, ça a été une espèce de libération de cette pensée française très cartésienne avec laquelle on avance tout le temps droit devant, avec des convictions affirmées. Kurosawa aimait beaucoup la façon dont je le traduisais à l’oral car il s’apercevait qu’il pouvait enfin converser avec les étrangers. J’introduisais de la logique dans ses phrases alors qu’avant, on le traduisait littéralement et ça ne permettait pas vraiment le dialogue. Et il adorait parler avec ses confrères étrangers.
J’ai donc été prise par cette langue. Je m’étais demandé que faire plus tard. Je voulais devenir madame Japon pour l’Europe ! Comme économiste, c’était une très bonne idée. Mes professeurs auraient voulu que je devienne chercheuse. J’ai été tentée par le journalisme. Mais j’ai préféré être interprète. J’aimais le passage d’une langue à une autre, la traduction. À l’oral, surtout, je n’aime pas tellement l’écrit.
Pourtant, le sous-titrage est une forme de traduction écrite.
Pour moi, les sous-titres, c’est de l’oral. Mais ce n’est pas de l’oral pur. La mise en forme écrite est passionnante. Je n’aime plus beaucoup le métier d’interprète. Je ne le fais plus que pour les cinéastes et quelques autres créateurs. Mais les hommes politiques, ça suffit.
Les parrains
Mes deux parrains dans le métier ont été Chris Marker et Kurosawa. Comme je l’ai déjà écrit plusieurs fois, Chris m’a dit : « Il y a trois règles pour le sous-titrage : l’image, l’image, l’image. » Cela voulait dire, premièrement, essayer d’empiéter le moins possible sur l’image, c’est-à-dire ne faire que des sous-titres d’une ligne. C’est une question de découpage. Deuxièmement, respecter l’ordre des mots japonais de sorte que le spectateur entende et lise en même temps les noms propres du dialogue, par exemple. Ce n’est pas facile, car le japonais est une langue dont les verbes viennent à la fin.
Je peux vous donner un exemple. Dans un film qui n’est pas de Kurosawa, Les Trois Samouraïs hors-la-loi (Sanbiki no samurai, Hideo Gosha, 1964), un samouraï découvre qu’il est amoureux d’une femme et lui avoue : « Celui qui a tué ton mari, c’est moi. » La phrase est à cheval sur deux plans, « c’est moi » tombant sur un gros plan du personnage. Pour traduire dans un français naturel, une précédente traductrice avait écrit : « C’est moi qui ai tué // ton mari. » Ça ne fonctionnait pas, car « ton mari » arrivait à contre-plan. C’est la raison pour laquelle, en japonais, cette règle de « l’image, l’image, l’image » aboutit à des sous-titres qui ne sont pas toujours très fluides. Mais dans la mesure où l’image montre l’acteur en train d’exprimer quelque chose, elle est incontournable.
L’image prime, mais alors quelle est la place du son dans le sous-titrage ?
Le son est au service de l’image. En sous-titrage, on ne recrée pas un texte, contrairement à ce qui se fait en doublage. Le cinéma, c’est d’abord une image, ou plutôt des images animées comme disait Kurosawa.
Troisième principe, respecter la scansion. De nos jours, les directeurs techniques des sociétés de distribution qui assistent aux simulations me demandent d’ôter les interjections telles que « holà ! ». Je suis plus encline qu’auparavant à le faire. Avant, je suivais de très près le rythme de la phrase afin que les spectateurs aient l’impression de voir des « sous-titres invisibles ». Mais c’était l’époque où il n’y avait pas de simulation. Ce qui est délicat aujourd’hui, ce sont les patrons de sociétés de distribution qui relisent les listes de sous-titres, sans l’image. Dans ce cas, j’accepte une partie de leurs remarques, mais je proteste aussi par endroits. Relire les sous-titres sans l’image, c’est dur. Sur le principe, j’apprécie les relectures qui permettent de fluidifier le texte, quand je suis trop « collée » au japonais. Mais certaines demandes sont irrecevables et j’argumente pour faire passer mes choix.
Pour la forme, mon parrain a donc été Chris Marker, et pour le fond, ce fut Akira Kurosawa, avec Ran. Kurosawa expliquait ce qu’il voulait faire. Je connaissais tout le travail derrière le choix des mots, j’étais vraiment obligée de respecter ses partis pris.
Et avec Chris Marker, comment cela s’est-il passé ? C’est intéressant que ce soit lui qui vous ait dit, non pas comment fonctionnait la traduction, mais quelle était sa conception de la traduction.
C’est lui qui sous-titrait ses films car il savait très précisément ce qu’il voulait. Il relisait les sous-titres vers l’anglais avec une grande attention et il était très, très exigeant. Pour AK, ma « valeur ajoutée » a été modeste. J’ai joué sur la cohérence des mots avec l’image. Mais ce sous-titrage était vraiment une œuvre collective et c’est pour ça que ce n’est pas signé.
Chris Marker avait beaucoup travaillé avec Yuko Fukusaki, en qui il avait toute confiance. Elle lui avait donné toutes les nuances. Il a fait des corrections même après que j’ai terminé les sous-titres d’AK. Comme il était à Okinawa quand on a fini les sous-titres, il m’avait donné la responsabilité des choses, mais il a quand même encore fait des corrections. Il était très, très, très méticuleux. Moi, je n’ai aucun amour-propre. Je ne suis pas l’auteure qui va défendre absolument sa traduction. Je suis toujours prête à l’enrichir. Par contre, je ne veux pas qu’on me l’appauvrisse. Mais le réalisateur, lui, il a tous les droits.
La langue japonaise et le sous-titrage
Vous avez souligné l’ambiguïté du japonais. Est-ce que Kurosawa ou d’autres cinéastes dont vous avez traduit les films se sont particulièrement servis de cette ambiguïté ?
Non, pas du tout. C’est la langue qui est comme ça. Et certains cinéastes écrivent des dialogues plus ambigus que d’autres. Naomi Kawase est la championne de l’ambiguïté. Kurosawa, non : il a une langue très construite, c’est pour ça qu’il est considéré un peu à la limite de l’occidental. Je viens de retraduire des films anciens qui avaient été sans doute traduits à partir de sous-titres anglais faits au Japon (donc, plus ou moins « censurés », c’est-à-dire simplifiés) : Vivre [Ikiru, 1952], Les Bas-fonds [Donzoko, 1957] et Yojimbo [1961]. Le traduire intégralement ne pose pas problème et je n’ai pas trop de problèmes pour trouver les termes. Mais Naomi Kawase, c’est l’aventure : prenons le film qui était à Cannes [en 2014], Still the Water, il y a encore des traductions dont je ne suis pas sûre. Par exemple, un vieil homme dit aux deux jeunes : « Faites tout ce que vous avez envie de faire. » Et le jeune lui dit : « Vous avez fait ça aussi ? – Non, moi j’étais trop “okubyô”. » Ça veut dire soit « timide », soit « lâche » : « Je ne l’ai pas fait par lâcheté ou par timidité. » Je cherche dans le dictionnaire, je vois vraiment les deux mots et, instinctivement, j’ai mis « lâcheté ». Puis, quand je l’ai vu écrit, j’ai dit : « C’est trop fort, on va mettre “timidité”. »
« Je n’ai pas osé », par exemple ?
J’y ai pensé, mais je ne sais plus ce que j’ai mis finalement. Ce qui était drôle, c’est que l’anglais a été traduit après le français. On devait se coordonner puisque, pour Cannes, les deux langues sont projetées en même temps, et on a eu la même discussion avec le traducteur anglais. Il m’a suivie en mettant « timidité », et puis finalement, il a mis « lâcheté ». « Je n’ai pas osé… » Mais pourquoi ? Dans la phrase, le personnage dit qu’il n’a pas osé, mais pourquoi ? Par timidité ou par lâcheté ? Il n’y a pas la réponse. Je ne sais pas… je crois que finalement, je suis revenue à « lâcheté ».
Pouviez-vous demander à la réalisatrice ?
Je le lui ai demandé, en anglais. Elle m’a dit : « Je ne sais pas, c’est ton problème. » [rires] Elle a entièrement confiance en moi parce qu’elle a eu la Caméra d’or pour [son premier long métrage] Suzaku [1997]. Pour Suzaku, Jiro Terao, le copain sous-titreur japonais qui traduit les films de Godard et de Truffaut et qui m’avait recommandée à Naomi, m’avait dit : « Bonne chance, parce qu’on ne comprend rien à ce qu’elle dit, on ne comprend rien au film. » Effectivement, quand j’ai traduit, j’ai essayé de clarifier les situations. Finalement, les Japonais présents à Cannes ont dit : « Avec les sous-titres français, on comprend le film, sinon en japonais, on ne comprend pas. » [rires] Ça, c’est mon problème : souvent, je donne un sens et après, je suis angoissée, parce que c’est le sens que je donne qui devient le sens.
Mon travail de base consiste à clarifier les situations et les relations, à bien présenter les personnages : ils ont un certain vocabulaire, un certain niveau de langage. J’essaie donc de leur donner le ton qu’il leur faut. Et puis, il y a un problème japonais : on appelle souvent les gens par leur position dans la famille, « grand frère » ou « petite sœur », etc. Quand ce n’est pas nécessaire, je ne le mets pas, mais c’est parfois très nécessaire.
Les appellations familiales propres au japonais vous ont-elles posé d’autres difficultés ?
Dans Rhapsodie en août [Hachi-gatsu no kyôshikyoku, 1991] de Kurosawa, il est question du rapport avec la bombe et avec les Américains. C’est l’histoire d’une vieille dame de Nagasaki dont le mari est mort des suites de la bombe atomique. Elle reçoit une lettre des États-Unis, d’un de ses frères, mais elle ne se souvient pas de l’existence de ce frère. Il lui écrit : « J’aimerais vous voir avant de mourir. Venez me voir aux États-Unis. » Et la grand-mère se dit : « Ce n’est pas possible, je n’ai pas de frère aux États-Unis. » Elle ne va pas aux États-Unis, mais ses enfants y vont et lui laissent ses petits-enfants. C’est un film un petit peu artificiel, pas très réussi de Kurosawa. C’est l’avant-dernier, avant Madadayo [1993].
Les enfants sont donc à la garde de leur grand-mère. Pour lui prouver que le frère des États-Unis existe bel et bien, ils font la liste de la fratrie de la grand-mère. Il y avait dix enfants et tous leurs prénoms étaient écrits « avec la clé du métal ». Si je vous écris « la clé du métal », vous ne comprenez pas du tout. Les noms japonais sont écrits en idéogrammes et un idéogramme se compose de deux éléments : la « clé » et l’élément phonétique. La clé du métal, ça veut dire que tous les noms de métaux seront écrits avec cette clé. Dans le sous-titrage anglais, ils avaient effectivement mis : « Tous ces noms sont écrits avec la clé du métal. » Mais je trouvais que cela ne voulait rien dire.
Revenons à l’image : on voit l’aîné des petits-enfants écrire au tableau noir et expliquer à ses frères et sœurs, ses cousins : « Tu vois, le premier, il s’appelle… » Une possibilité consiste à mettre : Tetsutaro, l’aîné, Dosaburo, le troisième, Jûshiro, le quatrième, Shôgoro, le cinquième. C’est ce qu’ils avaient mis en anglais, et tout ça s’écrit avec « la clé du métal ». J’ai pris le parti de traduire : « Fer, l’aîné. Cuivre, le troisième. Fusil, le quatrième. Carillon, le cinquième. Clou, le petit. Serpe du bonheur, Soc d’abondance, Grelot de bonheur. » Les filles s’appellent Nabé – c’est vachement sympa : « Marmite » ! – et Kané, c’est Clarine. À l’écrit, c’est faisable, mais je ne pense pas qu’on puisse faire ça en doublage5.
C’est donc une sorte de traduction littérale de leurs noms ?
C’est la traduction exacte de leurs noms. J’ai mis « Fer, l’aîné » : taro, ça veut toujours dire l’aîné. Je l’ai traduit, mais on le voyait à l’écran et on l’entendait, je pouvais me le permettre. À Cannes, Kurosawa l’a vu et m’a dit : « Tu as fait ça ? » [rires] Il a compris que j’avais traduit. Après, j’ai mis : « Tous les noms comportent la clé du métal. » Et ça fonctionnait !
C’était donc pour prouver que le deuxième frère, celui qui avait signé sa lettre, Suzujiro, était bien un frère aîné puisqu’il s’appelait « Étain, le deuxième ». C’était celui qui manquait. C’est très important pour le film. J’ai vu le DVD et je crois qu’ils ont supprimé cette traduction. Ils sont revenus à la traduction en anglais. Ça me rend malade, parce que Kurosawa avait adoré cette audace et en avait reconnu la nécessité.
L’idée d’appeler une femme par son prénom ne choque-t-elle pas les Japonais ? Pour désigner une mère, on dit « Maman ». Tout le monde dit « Maman », même son mari, non ?
Dans Désir meurtrier [Akai Satsui, 1964] de Shôhei Imamura, la femme parle de son mari en disant « Papa ». Elle est plus jeune que son mari et elle dit « oto san ». Ce n’est pas son père, mais tout le monde a cru qu’il l’était. J’étais très ennuyée et je crois que j’ai rechangé en disant « le père ». Dans Suzaku, le film de Naomi, les gens sont situés par rapport à leur âge. La petite fille joue avec un petit garçon qu’elle appelle « onii san » (littéralement « grand frère »). Ils ont six ans. On les retrouve dix ans plus tard et elle est amoureuse de lui. On pense toute suite à l’inceste, c’est compliqué. Alors que c’est un cousin. Aussi, j’ai mis « cousin » dès le début pour éviter les fausses pistes. Chaque fois, les relations familiales ou sociales posent problème en japonais. On s’appelle par la place dans la famille ou dans la société, mais pas toujours. Dans Bonjour [Ohayo, 1959] d’Ozu, les voisines s’appellent toujours « madame », « okusan », ce qui est très formel. Moi, j’ai mis « voisine ». « Madame », ça fait quand même bizarre !
Et en même temps, en français, on ne dirait pas naturellement « Voisine ! » pour apostropher quelqu’un.
Non, mais qu’est-ce qu’on met ?
Le prénom, peut-être…
Je ne le connaissais pas ! Et, en plus, c’est impensable que des voisines japonaises de ces années-là s’appellent par leur prénom ! J’ai eu le problème dans un film de Yôji Yamada, La Maison au toit rouge [Chiisai ouchi, 2014] qui est sorti au printemps 2015. C’est l’histoire d’un jeune couple qui vieillit au cours du film. Elle appelle son mari « anata », qu’on peut parfois traduire par « mon chéri ». En anglais, ils avaient systématiquement mis le prénom du mari. Moi, ça me choque de la voir appeler son mari par son prénom. Au début, j’ai donc mis « mon chéri ». Quand elle parle de lui à la bonne, elle dit : « Vous direz à Monsieur… », mais quand elle parle de lui avec la sœur du mari, je ne pouvais pas dire « monsieur ». J’ai été obligée de mettre le prénom, une fois ou deux, tant pis. Mais il était impensable qu’elle appelle systématiquement son mari par son prénom. Pourquoi ? Parce que « l’image, l’image, l’image » : ce n’est pas la relation d’une femme qui parle à son mari avec un prénom. Ça ne va pas. On sent qu’il y a une relation plus sociologique que personnelle.
C’est pourtant une relation intime.
C’est une relation intime, mais on le comprend par d’autres mots.
Se pose aussi le choix entre tutoiement et vouvoiement.
C’est le grand problème du japonais, mais pas seulement du japonais. Je ne pourrais pas imaginer une femme de samouraï tutoyant son mari et j’ai toujours opté pour le vouvoiement. Un samouraï, par contre, tutoie sa femme. En japonais, il n’y a pas de pronoms personnels. La pensée s’exprime par les verbes. Dès qu’il y a des jeux de mots, des gradations de politesse, incorporés dans le verbe, on peut très bien juger du niveau de relation : tu ou vous ? C’est assez intuitif, ce n’est pas scientifique du tout, ce n’est pas clair comme chez nous, mais je pense vraiment qu’un samouraï tutoie sa femme et qu’une femme vouvoie son mari.
On est confronté au même genre de situation avec l’anglais. Mais c’est exacerbé avec le japonais.
C’est un peu plus compliqué. En anglais, on a « you », mais en japonais, on n’a même pas ça. Je pense que c’est la plus grosse difficulté. On revient toujours à « l’image, l’image, l’image », et on essaie de VOIR si l’image montre une femme qui tutoie son mari.
Chez les samouraïs, c’est une chose, mais dans des films plus récents, avec des milieux moins traditionnels ?
Dans Tel père, tel fils [Soshite chichi ni naru, 2013] de Hirokazu Kore-eda, je pense qu’ils se tutoient. J’évite de les appeler par les prénoms, mais s’il le faut, je le fais. Dans les films montrant des situations modernes, comme Still the Water, oui, ils se tutoient.
Évolution de la langue japonaise au cinéma
L’emploi de mots très particuliers pour désigner la personne en fonction de son rang d’ancienneté ou d’âge, dans la famille ou dans les relations sociales, a-t-il évolué ? La langue a-t-elle changé depuis trente ou cinquante ans d’une manière qui se retrouve aussi dans les films ?
Oui, absolument, il y a une évolution. On la retrouve dans les films contemporains. Les femmes continuent à appeler leur mari « mon mari », mais elles peuvent aller jusqu’à dire le prénom, maintenant. Ça change avec les nouvelles générations et puis, il y a l’influence de l’étranger. Le Japon s’ouvre, la langue aussi.
Le japonais des films de Naomi Kawase est-il différent de celui d’Imamura, par exemple ?
Oui. Il est de plus en plus ambigu. Chez Imamura, c’est très écrit, je n’ai pas tellement de difficulté, à part les relations familiales. Chez Kitano, c’est beaucoup plus moderne et il n’y a pas de sujet. Alors, c’est à moi de trouver le sujet ! [rires]
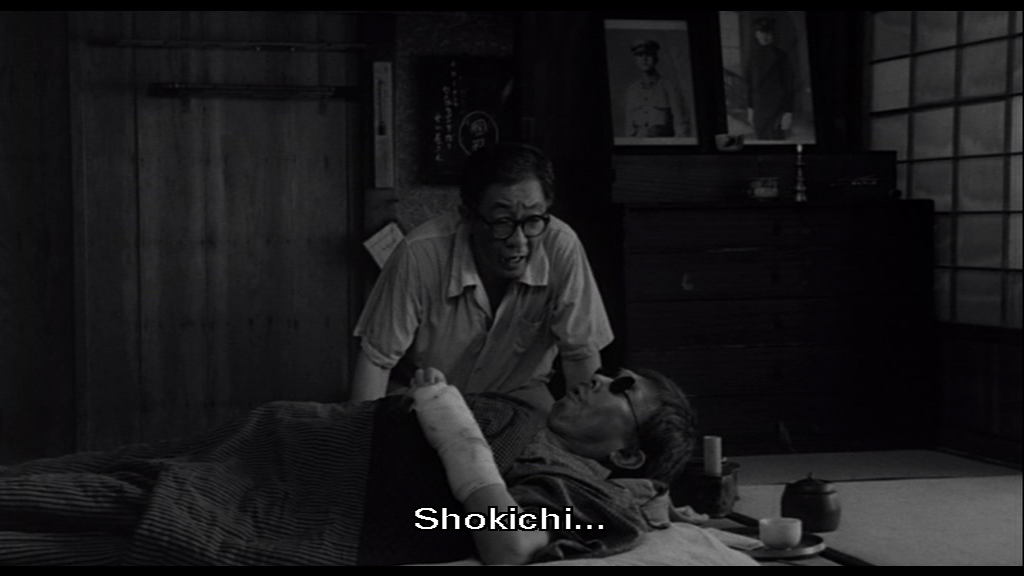
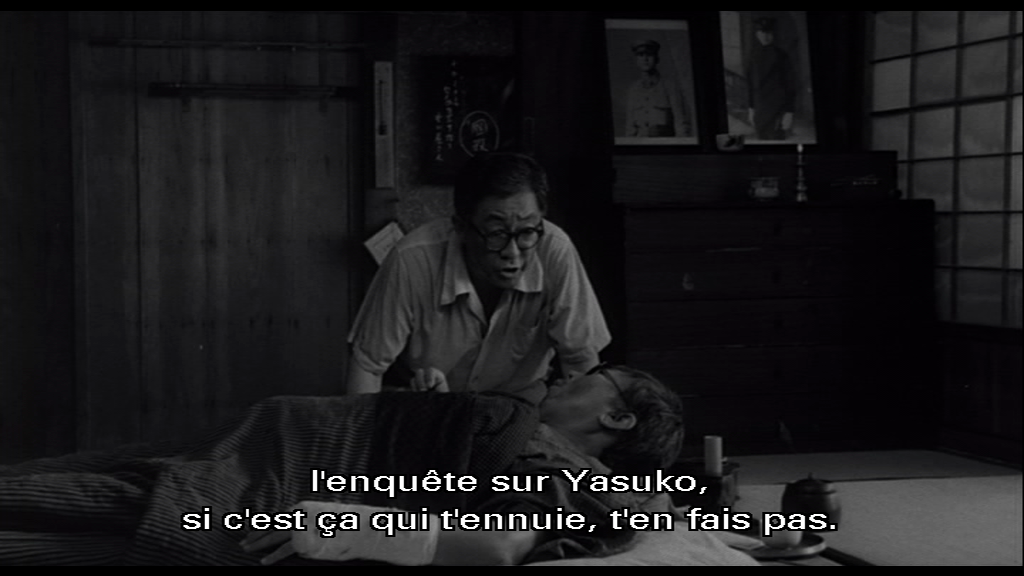
La langue devient-elle de plus en plus épurée ?
Elle est de plus en plus ambiguë et vague.
Pour les spectateurs japonais aussi ?
Ils ne comprennent pas toujours. Souvent, ils me disent : « On ne comprend pas les films de Kawase, par exemple, on ne sait pas très bien. » Le plus souvent, je me débrouille avec cette ambiguïté, mais je n’aime pas ça du tout. Je préfère traduire les films de Kurosawa et d’Imamura. Ça me repose. Avec eux, je suis sur des rails.
Langue et époque
Justement, de Kurosawa, vous avez notamment sous-titré Le Château de l’araignée [Kumonosu-jo, 1957], d’après Macbeth de Shakespeare. Vous souvenez-vous des difficultés particulières que posait ce film, du point de vue de la langue employée ?
Le vocabulaire de l’esprit de la forêt qui remplace les trois sorcières de Macbeth est très imaginatif. Kurosawa, qui disait que plus on est japonais, plus on est universel, nous a donné une représentation du monde très japonaise : en montrant un esprit malin, il voulait éviter de tomber dans le piège du vocabulaire de Macbeth. Il m’a donc fallu me calquer sur la représentation japonaise du monde, sur la structure féodale de l’époque. Et c’est parce que c’est un film très japonais qu’on prend la mesure de son universalité.
Lorsque vous sous-titrez des films qui appartiennent à une même période – des films de Naruse et de Kurosawa des années 1950, ou les derniers Ozu – êtes-vous confrontée à des différences de langue qui seraient propres à chaque cinéaste ?
Oui, le vocabulaire de Naruse est différent de celui d’Ozu, à l’image de leur écriture très différente. Mais ces films appartiennent à une époque où, effectivement, les scénarios étaient très écrits.
J’ai été confrontée à un problème à la fois similaire et différent : je viens de traduire La Maison au toit rouge de Yamada, qui parle de la montée du militarisme au Japon dans les années 1930, film qu’il a réalisé en 2014. Et puis, j’ai traduit presque simultanément un inédit d’Akira Kurosawa qui s’appelle Pas de regrets pour ma jeunesse [Waga seishun ni kui nashi, 1946], à propos de cette même époque, mais qui a été fait en 1946. Ils parlent plus ou moins de la même époque, mais pas du tout avec la même langue.
Même s’ils parlent de la même époque, celui de Yamada est davantage marqué par la langue actuelle ?
Absolument.
Et cela n’introduit pas un décalage avec une langue d’aujourd’hui censée parler d’une autre époque ?
C’est peu sensible. C’est très subtil. Je le sens, mais, au niveau du rendu, je ne peux pas. Cela n’a pas forcément de conséquences. En plus, Yamada est très, très proche de Kurosawa qu’il aimait. Il a donc fait des efforts pour gommer l’excès de modernité. Pour la situation sociale qu’il peignait, il a été guidé par les relations de couple des années 1930. Le degré de politesse est peut-être moins sensible. Ça se perd dans la traduction. Si on le rendait fidèlement, cela pourrait sembler artificiel.
La perception du japonais en français
La perception de la langue japonaise en France a évolué. Avez-vous observé cette évolution en tant que sous-titreuse et traductrice ? Y a-t-il des mots que vous explicitiez à une époque, mais qui ne le nécessitent plus aujourd’hui ?
Oui, bien sûr. Il faudrait revenir à Tampopo, où c’était quand même la première fois qu’on parlait de la cuisine japonaise en français. Je cherchais des équivalences tout le temps car je voulais absolument entraîner les spectateurs dans cette épopée gastronomique. Je regardais récemment un dossier sur le sous-titrage en France dans lequel on m’a reproché d’avoir traduit « manjû » par « brioche fourrée ». Mais je ne veux pas laisser des noms de spécialités japonaises dans le flou d’une dénomination exotique. J’ai eu une grande discussion avec Kore-eda à propos d’un gâteau spécifique. Il me disait de laisser le mot japonais et je lui ai répondu : « Non, on doit comprendre ce que c’est. » Cela arrive fréquemment avec lui qui adore les gâteaux.
On comprend « sushi » aujourd’hui, mais il y a trente ans, on ne l’aurait pas compris.
En effet. Dans La Maison au toit rouge, le film de Yamada, où on parle de tonkatsu, des côtelettes de porc grillées et panées. Le distributeur français du film me dit : « On enlève “panées”. » Je réponds : « Non, on ne peut pas enlever “panées”. » On imagine ça avec des oignons, alors que le tonkatsu, c’est vraiment très spécifique. J’ai dit : « On le laisse une fois, après on mettra tonkatsu. » Je le traduis une fois en entier et ensuite, je le mets en japonais. Je ne peux pas accepter qu’on mette « côtelettes de porc », ça n’a rien à voir.
Il faut toujours traduire au moins une fois les spécialités culinaires japonaises car il m’est arrivé un truc drôle avec Tel père, tel fils de Kore-eda. À un moment, il est question de udon : « Est-ce que tu veux manger des udon ? » La distributrice m’avait dit : « On peut laisser udon, c’est connu. » À la première projection de presse, les journalistes sont tous sortis très contents, très émus, mais plusieurs ont demandé : « Qu’est-ce que c’est que les udon ? » J’avais cédé à l’insistance de la distributrice et de la simulatrice qui adoraient les udon, mais il a fallu corriger : « On a reçu des nouilles. – Tu veux des udon ? » J’ai mis une fois la traduction et, juste après, « udon ». Après les avoir traduits,j’essaie de garder des mots japonais, car rien n’est mieux que le son venant en renfort de l’image, l’image, l’image…
Le sous-titrage avant l’informatisation
Vous avez commencé à traduire des films au milieu des années 1980, juste avant la vidéo et l’informatisation du sous-titrage, lorsque le repérage se faisait sur pellicule…
Oui, jusqu’en 1990, c’était sur le déroulant. Les repéreuses repéraient au son et je venais après pour valider leur repérage et éventuellement le modifier.
Le déroulant, c’est-à-dire la bande-pilote sur laquelle étaient portées à la main les marques du repérage ?
Oui, j’ai commencé comme ça, chez Cinétitres. On nous donnait des listes sur papier avec les temps de lecture où tout était écrit à la main. J’ai encore de nombreuses listes de sous-titres écrits à la main, dont Ran, par exemple. Et on faisait la relecture sur épreuves.
À l’époque du repérage sur pellicule, comment voyiez-vous le film ?
Je le voyais une fois en projection et après, je ne l’avais pas sous la main. J’avais toujours des problèmes, justement, entre le pluriel et le singulier. Par exemple, quand on parle de tasses : « Prends-la » ou « Prends-les » ? Si vous n’avez pas remarqué combien de tasses il y avait à la projection…
Il n’y a pas de différence en japonais ?
Non, il n’y a qu’un seul mot (kappu). Alors, j’essayais d’éviter le plus possible les compléments d’objet direct, parce que je ne pouvais pas revoir le film. Quand c’était Kurosawa, je pouvais appeler le Japon, et je leur demandais. Pour Ran, j’ai beaucoup téléphoné, en disant : « Là, combien on en voit à l’image ? » Et ils ne comprenaient pas mes questions. Je disais, par exemple : « Combien il y a de chevaux ? » Est-ce que c’est « Amène le cheval » ou « Amène les chevaux » ?
Repérage et simulation
À propos des travaux « annexes », faites-vous le repérage vous-même ?
On est obligés de faire le repérage avec les repéreurs puisqu’ils ne peuvent pas porter le découpage sur les dialogues. Pour nous, traducteurs du japonais, ça fait partie du boulot. Mais, en même temps, je pense que le repérage joue un rôle important dans la traduction et que c’est excellent d’y participer.
Depuis le début ?
Depuis le début, et même maintenant. Le repérage, je l’ai appris avec Hiroko Govaers sur AK de Chris Marker. Dans la mesure où vous avez un script en japonais, vous le découpez.
Si on ne lit pas le japonais, on ne peut pas faire le repérage.
En effet, et cela nous oblige à assister au repérage. Quelquefois, on me donne un repérage. Pour un film sur cinq, maintenant, j’ai le repérage d’après le sous-titrage anglais fait au Japon. Pour le dernier film de Yamada, on m’a donné le repérage anglais. Je me suis calée dessus, mais je modifie. Je pense que le repérage est très, très important. C’est nous qui le faisons, avec le repéreur ou la repéreuse. Ce qu’ils font chez Titra Film, et que j’adore, c’est un pré-repérage. Il me suffit de venir pour mettre les numéros des sous-titres sur le script. Ça se fait très vite, mais cela permet aussi de modifier le découpage avant la traduction. Un film de 1 500 ou 2 000 sous-titres, je le repère en quatre ou cinq heures. La repéreuse me dit « numéro 1, 2, 3 », etc. J’écoute le dialogue et je note le numéro de sous-titre, tac, tac, et je peux toujours dire : « Non, là, tu peux couper comme ça… »
Couper ou regrouper…
Regrouper, re-couper… Souvent, c’est très bien parce qu’ils le font au son, mais ils ne peuvent pas le mettre sur le scénario, donc je suis obligée d’être là. Sauf maintenant, quand on le fait à partir de l’anglais. On ne fait pas la traduction à partir de l’anglais, mais le repérage se base sur l’anglais.
Ce type de repérage vous convient ou bien êtes-vous souvent obligée d’ajuster ?
La plupart du temps, il me convient. J’ajuste quelquefois, d’abord à cause des changements de plan qui ne sont pas respectés par les labos japonais. Quelquefois, c’est trop long. J’aime mieux que ça colle au rythme de la phrase, donc on dédouble pas mal par rapport au japonais. Les Japonais s’en fichent de mettre des sous-titres de deux lignes. Ce n’est pas que je tienne à ne mettre que des « une ligne » : j’en fais beaucoup de deux lignes maintenant. Mais quand il y a de trop grandes phrases, on n’aime pas. Et souvent, ça dépasse les 84 signes. Au Japon, ça leur est égal car ils découpent selon la grammaire, pas selon le son ou l’image.
Au Japon, ils font des sous-titres qui sont de bons pavés, et nous, on les découpe. Mais ça dépend des auteurs et du laboratoire de sous-titrage. Certains labos japonais travaillent presque comme nous, et d’autres pas du tout. Ils ont appris à partir de notre manière de faire. Ce qu’il y a de bien avec les Japonais, c’est qu’ils apprennent beaucoup. Jusqu’en 1997, les repérages japonais n’étaient pas terribles. C’est avec Naomi Kawase que j’ai parlé pas mal de sous-titrage. Et je pense qu’après, ils ont fait du feedback et les labos japonais ont commencé à regarder comment étaient sous-titrés les films en France. Et ils ont travaillé beaucoup mieux, je crois.
Reprenez-vous beaucoup de choses à la simulation ?
Ah oui, beaucoup. Beaucoup trop, peut-être. C’est d’ailleurs paradoxal, puisque j’ai dû traduire plus d’une centaine de films sans avoir pu les simuler. Aux débuts de la simulation, cette étape était facturée à part et peu de distributeurs acceptaient de payer cette surcharge de coûts. Alors, maintenant, j’en abuse. Je refuse de donner mes listes aux distributeurs avant la simulation. Ça donne des discussions intéressantes avec les directeurs techniques qui viennent à la simulation. La demande la plus fréquente est de « moderniser » les dialogues. Mais ce n’est pas toujours possible. Par exemple, dans Pas de Regrets pour ma jeunesse, on me demande de mettre « la lutte des classes » au lieu des « luttes de gauche ». Je dois expliquer qu’il ne s’agit pas de la même chose, de la même époque, ni du même milieu sociologique.
Dans une scène, une femme de professeur dit : « Ah, ces savants, ils sont tout le temps dans la lune », ou quelque chose comme ça. On me demande de mettre : « Ces intellectuels. » Je me souviens que quand Sartre est allé au Japon dans les années 1970, il y a eu une grande discussion entre des intellectuels japonais et lui. L’expression « un intellectuel » n’existait pas. C’est une invention de Sartre. L’adjectif existe, mais pas « un intellectuel ». Je ne peux pas faire dire à la femme du prof, dans les années 1930, « Ah, ces intellectuels » en parlant de son mari ! Ça n’a pas de sens.
Mais je change beaucoup de choses à la simulation qui, avec moi, dure en moyenne six à huit heures. Ça a changé ma manière de travailler. Pas forcément pour le meilleur. Je suis devenue moins exigeante sur le nombre de signes. Résultat : je finis le travail à la simu car je n’utilise pas de logiciel de sous-titrage.
Re-sous-titrer d’anciens films
Vous sous-titrez aussi bien des films contemporains que des films anciens à nouveau distribués ou édités en DVD.
Oui. Par exemple, Wild Side m’a demandé de « réviser » les sous-titres de Vivre d’Akira Kurosawa pour une sortie prochaine. C’est un chef-d’œuvre. Tout le monde dit que c’est le plus grand Kurosawa, mais avec les sous-titres qui collent bien, on découvre un nouveau film.
C’est malheureusement assez rare que les distributeurs français acceptent de payer un nouveau sous-titrage pour d’anciens films japonais, qui en ont pourtant souvent bien besoin. Aux États-Unis, quand j’ai vu La Condition de l’Homme [Masaki Kobayashi, 1959-1961] avec Tatsuya Nakadai, sous-titré par Criterion, je me suis dit : « Ça n’a rien à voir avec les sous-titres français. Il faudrait le refaire en français. » Je me souviens que lorsqu’Arte a édité un coffret DVD de six films de Kurosawa, le distributeur Connaissance du cinéma sortait à peu près à la même époque d’autres films anciens du même Kurosawa. Et Jean Douchet, qui participait à cette édition, m’avait dit, tout content : « Vous avez vu ce qu’on a fait ? » Quand je lui ai reproché de les avoir édités avec les vieux sous-titres vraiment indignes, il n’a pas eu d’autre excuse que : « Mais on n’a pas l’argent ! – Ce n’est pas bien. Le sous-titrage, ça ne coûte pas une fortune. Il ne faut pas exagérer ! » J’étais furieuse, parce que j’avais l’habitude de traduire pour lui. Pour les cinq films de Keisuke Kinoshita édités chez MK2, ils ont négocié sur le tarif en disant : « Oh, ce n’est que pour des DVD… » et j’ai accepté. C’est paradoxal car finalement, ce sont les sous-titres des DVD qui comptent le plus, puisqu’ils peuvent être regardés un grand nombre de fois.
Pour les quatre films de Kurosawa, dont un inédit, que Wild Side m’a demandé de faire, on m’a dit : « Oh, ce n’est que réviser les sous-titres. » Mais ça m’a demandé un boulot ! Maintenant qu’ils ont revu le film avec les bons sous-titres, ils me disent : « C’est tellement bien qu’on va peut-être le sortir en salles. » Alors, je vais renégocier le prix, mais je doute du succès. J’avais accepté en me disant : « Bon, c’est une chance, je vais refaire Vivre », mais ça m’a demandé plus de travail, parce que le repérage n’était ni fait ni à faire !
Parfois, cela n’a pas de sens de reprendre des sous-titres anciens et c’est souvent plus compliqué que de repartir de zéro. Mais il y a une prise de conscience chez certains distributeurs.
C’est vrai, mais il y a encore du chemin à faire. Il faudrait repartir du repérage. Ce serait plus simple et plus honnête. Quand il y a trop de trous, c’est quasi impossible de ravauder.
Tous ceux qui ont été faits avant la fin des années 1950 ont d’autant plus de trous que le repérage se faisait après la traduction.
Même dans les années 1960-1970. Moi, a priori, j’essaie de respecter les traductions anciennes mais, dans Yojimbo, par exemple, il y a un mot que j’avais laissé : pour le fabricant de cercueils, on lisait « tonnelier » parce que les cercueils, à l’époque féodale, étaient des espèces de tonneaux. J’avais mis « le tonnelier » et puis, en le relisant après trois mois de décantage… « Tonnelier », ça ne va pas du tout. J’ai posé la question à un cousin, entrepreneur de pompes funèbres : « Comment appelle-t-on un fabricant de cercueils ? – Un menuisier, tout simplement. »
Défis de traduction
Parmi les films que vous avez traduits, avez-vous des préférences en tant que traductrice plutôt que comme cinéphile, en raison des défis de traduction qu’ils ont pu comporter ?
Il y en avait un que j’aime beaucoup. C’est Le Testament du soir [Gogo no Yuigon-jo, Kaneto Shindo, 1995]. À cause de l’histoire, et de l’écriture qui coule bien. Pas de prouesses de traduction. Un des plus durs, mais des plus beaux, aussi, c’est Eureka [Yurîka, 2000] de Shinji Aoyama. Ça a été un grand succès, magnifique. Mais j’aime mieux les films qui passent naturellement, parce que je n’ai pas d’excentricités à faire dans la traduction.
Lesquels ? Ceux de Kurosawa, d’Imamura, peut-être ? Oshima ?
Oui, oui, absolument. Avec Imamura, je suis prise par la main. Kurosawa, c’est si bien écrit ! Masahiro Kobayashi aussi est impeccable, ses scénarios sont toujours très écrits, comme La Tragédie du Japon [Nihon no higeki, 2013]. Il écrit des dialogues très simples, très modernes ; là, je peux tutoyer sans problème.
Qu’est-ce que j’ai aimé ? Du point de vue de la traduction… La Légende du grand judo [Sugata Sanshiro, Akira Kurosawa, 1943]. Le passage du ju-jitsu au judo, de la Technique à la Voie de la souplesse. C’est le premier film de Kurosawa et j’ai beaucoup aimé le traduire. Tampopo, j’ai beaucoup aimé aussi car c’était un défi de traduction, à l’image de l’histoire du film qui était une satire de la société japonaise toujours en quête de la perfection.
On parle souvent de truculence à propos du cinéma d’Imamura et cette truculence se trouve aussi dans la langue, ainsi qu’une certaine crudité. Par rapport à d’autres cinéastes, pose-t-il plus de problèmes ?
Oui, mais c’est comme quand je traduisais les « roman-pornos »6, c’était écrit. À partir du moment où c’est écrit, on le suit, on est pris par la main. Ce sont vraiment des maîtres de l’écriture. Ensuite, on me dit : « Comment tu as osé traduire ça ? » Je réponds : « Je n’ai pas osé, c’est ce qu’ils disent ! » On s’en fiche, on est emporté. C’est très différent des films de Naomi Kawase, par exemple.
C’est elle, le cas extrême parmi les cinéastes ?
Il y a Kitano, aussi. Chez lui, il y a beaucoup de répétitions définitives : « Bakayarô ! (Connard !) » Il a recours à une forme d’expression minimaliste. Il s’exprime par interjections. C’est difficile de faire des phrases avec ça. Il faut reconstruire des semblants de dialogues… Tout est dans l’image et le mouvement, et il se fiche complètement des mots. Il dit vraiment n’importe quoi. Et c’est à nous de faire dire quelque chose à ces mots.
Connaissiez-vous « Beat » Takeshi, c’est-à-dire Takeshi Kitano avant qu’il ne passe à la réalisation ? Dans ses émissions de télé, il parlait sans arrêt et disait beaucoup de bêtises.
Non. Je ne regarde pas tellement la télé, mais je connaissais sa réputation, j’étais au courant pour « Beat » Takeshi. Et puis, il avait joué dans Furyo (Senjo no mêri kurismasu, 1983) de Nagisa Oshima où il était excellent. Le premier que j’ai traduit pour lui, c’était Kids Return [1996]. Il a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs et j’ai donc rencontré Kitano à Cannes où j’ai traduit ses interviews. Il avait un bagout étourdissant, mais ce qu’il disait était quand même très sensé et super brillant.
Et Furyo, vous l’aviez traduit à l’époque ?
Non. Furyo, c’était une expérience extraordinaire. En 1983, j’étais interprète pour Oshima, mais je n’ai pas fait les sous-titres de ce film. Il y avait une partie en japonais, et c’était Bernard Eisenschitz et Pierre Cottrell qui avaient fait les sous-titres à partir de la traduction anglaise. Eisenchitz et Cottrell voulaient savoir s’il n’y avait pas de faux-sens ou de contre-sens. J’ai voulu souligner certaines nuances. Mais ils m’ont rembarrée : « Mais non, ça, on ne peut pas le mettre, il n’y a pas la place ! » Et je me suis juré de ne jamais faire de sous-titrage ! Comme quoi, il ne faut jamais dire « jamais ».
Qui avait fait les sous-titres anglais de Furyo ?
Cela avait été fait au Japon.
Par Donald Richie7, peut-être ?
Donald Richie ne savait pas bien le japonais. Il le disait lui-même et il devait travailler avec un Japonais. Ce qui m’a posé des problèmes car j’ai découvert des erreurs de traduction sur Ran, sans savoir, d’ailleurs, que Donald Richie en était l’auteur et sans même connaître son nom. Une fois ou deux, je me souviens très bien, j’ai dit à l’assistante de Kurosawa : « Je suis désolée, je vous signale que l’anglais, ça ne va pas. » J’avais une bonne connaissance du japonais et, en plus, je voyais très souvent Kurosawa. J’allais beaucoup au Japon pour des festivals et il me demandait de venir au festival de Tokyo parce qu’il rencontrait des cinéastes étrangers. Quand François Mitterrand est allé au Japon en 1982, je devais être interprète pour l’Élysée, mais cela ne s’est pas fait. Finalement, c’est Kurosawa qui m’a payé le voyage pour faire la traduction entre lui et Mitterrand pour une demi-heure de rencontre, à peine.
Imamura, je l’ai rencontré au festival de Tokyo en 1987. Je traduisais sur scène les débats avec le public dans la section « Jeune cinéma ». Et puis, je voyais un type assez loin dans la salle, qui posait de bonnes questions. Je le voyais avec ses lunettes et un col roulé blanc, souvent. À la clôture, on me dit : « Il y a quelqu’un qui veut te voir », et on me présente Imamura. Et je fais : « Ah ! C’était vous, le jeune homme ! – Oui, j’adore la façon dont vous traduisez. D’ailleurs, vous traduisez très bien tous mes films. » J’en avais traduit cinq à l’époque. Je lui demande comment il le savait et il me répond : « Oh, on a des espions à Paris… » Ces « espions » regardaient les sous-titres et disaient à Imamura : « Elle traduit vachement bien. »
Mais, en effet, comment le savaient-ils ?
Beaucoup de Japonais trouvent que mes sous-titres sont très proches du japonais. Alors qu’un traducteur comme Jean-Marc Pannetier, l’auteur de doublage, déteste mes sous-titres, parce qu’il les trouve trop proches, justement. Ce sont des Français qui ne connaissent pas le japonais. Par contre, Anne et Georges Dutter8 disaient qu’ils les aimaient bien, parce qu’ils leur servaient beaucoup pour écrire leurs dialogues de doublage.
Il y a aussi eu une grande discussion avec Oshima qui s’était engueulé avec le réalisateur Noriaki Tsuchimoto que j’avais traduit à la Cinémathèque française. C’était à un dîner auquel participaient Oshima, Tsuchimoto, deux autres cinéastes, pour qui j’avais traduit aussi, et qui ont dit : « Catherine, elle traduit très bien, un prof de l’université de Tokyo l’a dit à la fac. » Oshima a explosé en disant : « On le sait qu’elle traduit bien, on n’a pas besoin d’un prof de l’université de Tokyo ! » Ils se sont disputés pour savoir si je traduisais bien ou pas. Oshima, qui était anarchiste, a dit à Tsuchimoto : « Toi et les communistes, vous avez toujours le respect des autorités ! » Je l’ai prié de se calmer car, après tout, Tsuchimoto n’avait rien dit de mal.
Mais il y a des « espions » japonais, et ils peuvent être très méchants car ils sont souvent prêts à dénoncer des traductions, à leurs yeux, insuffisantes. Il y en a un qui a relevé récemment que, dans Les Sept Samouraïs, je n’avais pas traduit : « Les paysans doivent se soumettre à ce qui est long. » C’est l’écrivain Akira Mizubayashi, qui écrit très bien en français9. Je me souviens avoir eu des problèmes pour traduire cette phrase très japonaise. J’ai essayé de respecter le sens, mais je ne pouvais pas traduire littéralement. Parce qu’au Japon, le pouvoir est quelque chose de long…
C’est ce qui est dit littéralement ?
« Nagaimono ni makareru n’dayo », ce qui veut dire littéralement : « Il faut s’enrouler autour de ce qui est long. » Ou, selon M. Mizubayashi, il eût fallu mettre : « Il faut céder au pouvoir. » Moi, j’ai traduit par : « Faut savoir s’adapter. » Cela venait après : « Les paysans doivent tout endurer. »
C’est très intéressant, parce qu’avec le cinéma japonais, tous les problèmes de traduction qu’on peut rencontrer sont réunis et exacerbés par la confrontation de la langue et du cinéma, et de ce qu’on doit en faire dans des sous-titres.
Le problème avec les sous-titres, en japonais, en particulier, c’est que n’importe qui connaissant un peu la langue peut vous dire : « Ça, ce n’est pas le mot exact. » Mais il n’y a pas de traduction unique, standardisée pour la moindre expression même récurrente. Et parfois, je ne suis toujours pas satisfaite. Comme pour « timide » et « lâche ». Je n’ai pas trouvé le mot idéal.
Des films en japonais de réalisateurs français
Vous avez fait vos débuts de sous-titreuse avec Chris Marker. Depuis, avez-vous travaillé sur des films tournés en japonais par d’autres réalisateurs français ?
Oui, avec Jean-Pierre Limosin qui a fait Tokyo Eyes [1998]. C’est un film génial que j’adore. Comme il l’a tourné au Japon, son scénario a d’abord été traduit en japonais par une amie critique de cinéma, Michiko Yoshitake. Ensuite, il a fallu sous-titrer du japonais vers le français. Michiko craignait qu’il y ait trop de décalage. J’ai fait l’atterrissage vers le français. Jean-Pierre Limosin est venu à la simulation. C’est quelqu’un d’adorable. Quelquefois, il me demandait de changer quelques mots : « Est-ce que tu peux mettre… Est-ce que ça peut avoir ce sens-là ? » Je disais : « Oui, oui, ça peut aller », en jouant avec l’amplitude des mots japonais. Moi, j’ai simplement traduit vers le français, mais comme je ne connaissais pas le scénario original, je n’ai pas toujours utilisé les mêmes mots. Quand ça pouvait coller, on gardait, sinon il acceptait des changements.
Par contre, j’ai dû travailler avec Leos Carax pour Tokyo ! [2008]10. Et là, j’étais folle de rage. Il prenait le japonais comme une musique et il ne voulait pas que l’on suive l’ordre japonais ! Par exemple, il y avait tout un énoncé de noms de pays. Je les avais mis dans l’ordre dans lesquels on les entendait en japonais. Et il disait : « Non. Il faut les mettre dans l’ordre français, c’est ce que j’ai écrit qui compte. » Je lui disais : « Mais vous l’entendez en japonais, nom d’une pipe ! »
Mais le comble, ce fut l’histoire du verdict du procès. Un carton disait : « Peine de mort. » Le verdict, c’était la peine de mort. Et il m’a dit : « Il faut mettre “peine de mort par pendaison”. » Je lui dis : « Mais c’est marqué “peine de mort”. » Lui : « Non, c’est “par pendaison”. C’est horrible, la pendaison. » Moi : « Si vous croyez que c’est mieux d’être guillotiné… » [rires] Il n’a pas aimé du tout ! C’est dans la scène suivante qu’on voyait la pendaison.
Vous avez quand même signé ce sous-titrage ?
Non, j’ai refusé de le signer. Carax avait dans sa tête son film jusqu’au bout, et il n’a pas voulu en démordre. Son assistante-monteuse était catastrophée, elle trouvait que je lui manquais totalement de respect. C’est vrai que le réalisateur peut faire ce qu’il veut. C’est son film, après tout. Mais le sous-titreur a le droit de ne pas signer. Limosin, lui, avait eu une attitude intelligente en reconnaissant qu’il y a des variations en japonais, il essayait de retrouver ses propres mots après le passage dans l’autre langue.
Mais dans l’histoire avec Leos Carax, ce qui m’a le plus choquée, c’était la négation du pouvoir de l’image et l’importance démesurée donnée aux mots. L’image de la pendaison était plus forte que l’annonce du carton. C’est toujours une histoire d’image.
Propos recueillis par Samuel Bréan et Jean-François Cornu à Paris, le 6 novembre 2014, et actualisés par Catherine Cadou le 6 octobre 2015.
