"Le sous-titrage, c'est extrêmement musical"
Entretien avec Henri Béhar, traducteur de films anglophones
Journaliste de radio, de télévision et pour la presse écrite, Henri Béhar est aussi traducteur pour le sous-titrage et interprète de différentes personnalités du cinéma lors d’entretiens publics en festivals ou d’interviews pour les médias. Sous-titreur de nombreux films anglophones, il a collaboré directement avec les cinéastes et producteurs des films qu’il a traduits, Woody Allen, Quentin Tarantino, Tim Robbins et Atom Egoyan, parmi bien d’autres.
En sous-titrage, un « dialogue » désigne un sous-titre qui réunit les propos de deux personnages. Dans cet entretien, dont la V. O. est tantôt en français tantôt en anglais, Henri Béhar relate souvent des conversations qu’il a eues avec des producteurs et des cinéastes en parlant, pour ainsi dire, « en dialogues ».
Vous traduisez principalement de l’anglais. Comment avez-vous appris cette langue, par vos études ?
De naissance. Je suis né au Caire et on parlait quatre langues sans même y penser. J’en ai perdu au moins deux, par manque de pratique. On ne se posait même pas la question : on parlait italien et on parlait grec sans effort.
Vous avez traduit majoritairement vers le français, mais vous indiquez dans la liste de films que vous avez traduits : « De et vers d’autres langues. » De quelles langues s’agit-il ?
Il y a un film chinois, que j’avais fait à New York avec quelqu’un qui parlait le chinois. Mais je ne me souviens absolument pas du titre. Je ne l’ai même pas répertorié dans mes « œuvres ». Il n’y avait trois fois rien. Du chinois vers l’anglais. Quand je travaillais avec Miramax, j’avais eu un film de l’espagnol vers l’anglais, Fraise et chocolat [Fresa y chocolate, Tomás Gutiérrez Alea, 1994]. Une amie de Gutiérrez à Cuba, qui était la présidente des Amitiés américano-cubaines, avait traduit ça comme si c’était un roman. Et un roman pour quelqu’un qui sait ce qu’est la vie à Cuba. Appeler tel endroit par son nom, pour nous, ça ne correspondait à rien. Nous, c’est : « Il est en prison ». Point. Harvey Weinstein1 avait révisé les choses en disant : « Ça, c’est pas clair. Ça, c’est pas clair. Je suggère ceci, je suggère cela. » J’ai repris tout en main avec quelqu’un de chez lui. Dès qu’on avait un problème, on appelait Harvey qui disait : « Appelez Gutiérrez à Cuba. » C’était sympathique ! On a passé un week-end… « solide ». Le texte a été fini le lundi en fin d’après-midi et livré par email. Mais ce que Weinstein avait oublié de me dire, c’est que le film sortait le mercredi. Les sous-titres ont été gravés le mardi et les copies tirées dans la nuit du mardi au mercredi pour que les films soient en place à neuf heures du matin ! Ça, c’est mes aventures espagnoles.
À la fin des années 1970, j’ai travaillé sur un film de Paul Vecchiali qui s’appelait Corps à cœur [1979], que j’avais traduit en anglais avec David Overbey, un ami journaliste américain en poste à Paris. On avait aussi traduit ensemble Court Circuits de Patrick Grandperret [1981].
Journalisme et sous-titrage
Lorsque vous avez commencé à sous-titrer, vous n’avez pas abandonné votre activité de journaliste, votre métier principal à l’époque.
Non. Je travaillais en radio et en télé.
Et avec quels magazines de cinéma collaboriez-vous ?
J’ai commencé à La Revue du cinéma, dans les années 1970. Pour une interview de Jack Nicholson à propos d’En route vers le sud [Goin’ South, 1978]. En projection j’avais croisé quelqu’un qui m’a dit : « Pourquoi t’écrirais pas pour nous ? Qu’est-ce que tu as ? – Je viens de faire une interview avec Nicholson. – Ah, c’est intéressant, fais voir. » Et elle a paru quasiment intégralement dans un des numéros suivants. À partir de là, je suis devenu un des collaborateurs de La Revue du cinéma2.
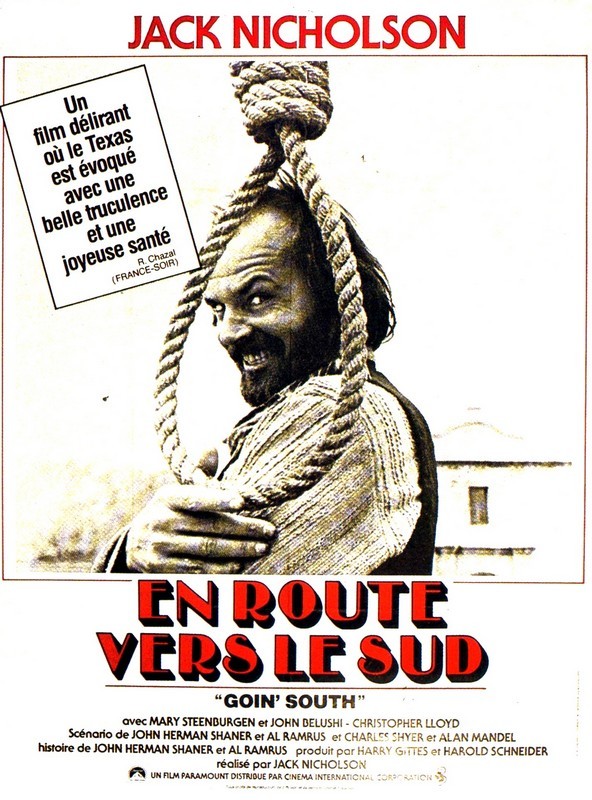
À la radio, vous travailliez spécifiquement sur les questions de cinéma ou vous faisiez un peu de tout ?
En radio, j’ai tout fait. Mais j’avais fini par faire des choses uniquement culturelles : cinéma, théâtre. On avait des émissions en direct à Inter-Variétés, qui était une partie de France Inter. Je me souviens avoir fait, pour la sortie du film de René Allio Rude journée pour la reine [1973], un plateau radio entre Simone Signoret et Marcelle Ségal, qui rédigeait le courrier du cœur du magazine Elle. Ça avait été filmé aussi pour la télé, ce qui ne se faisait jamais, avec un chef opérateur super sympa et super doué. Une vraie complicité s’est installée immédiatement entre Simone Signoret et lui. Elle a calmement allumé une cigarette et lui a offert la fumée la plus télégénique qui soit.
J’étais assistant de quelqu’un dont je suis devenu coproducteur. Et puis, on m’a demandé : « Est-ce que tu veux devenir producteur ? » J’ai fait « oui, pourquoi pas ? » Et c’est comme ça que ça a commencé. C’était dans les années 1960, ça. On faisait aussi de la télé, en même temps. On avait pensé à une télé en 1968 avec Pierre Dumayet, Pierre Desgraupes et tout ce monde-là3. On avait mis en chantier un truc sur la censure, avec des interviews d’Henri Langlois4, notamment. C’était assez rigolo à faire. Mais c’est uniquement parce que Dumayet m’avait dit : « Vous n’auriez pas une idée ? » J’étais en voiture, il attendait à une station de taxis pendant les grèves de 1968. Tout s’est enchaîné comme ça.
Et puis, un jour à Cannes, Marc Esposito et Jean-Pierre Lavoignat, qui en étaient au numéro six de Première, me disent : « Pourquoi tu n’écris pas pour nous ? – Vous ne me l’avez pas demandé. – Ben, on te le demande. – Ah bon, vous voulez quoi ? – Euh, Ken Russell, Noureyev… – Bon. » J’ai pu faire une demande à Noureyev et quatre jours après, voilà le papier !
À la télévision, il y avait un magazine de cinéma ?
Oui, cela s’appelait « À vous de voir ». Après l’éclatement de l’ORTF en… 92 chaînes, j’étais sur la 3. C’était toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus très bien.
Quand vous avez commencé à faire du sous-titrage, vous viviez à New York, vous étiez correspondant du Monde à ce moment-là ?
Première, puis Le Monde. Le Monde, c’est en 1985. Je crois que mon premier papier pour Le Monde – j’en avais fait douze feuillets, ils en avaient besoin de deux, mais personne ne m’avait prévenu –, c’était sur Out of Africa [Sydney Pollack, 1985].
Journaliste et interprète
Vous avez aussi été interprète pour traduire des cinéastes et des comédiens lors de conférences de presse, de rencontres publiques et d’interviews. L’interprétation ou la traduction de liaison dans le domaine du cinéma est très rarement évoquée. C’est pourquoi j’aimerais que nous en parlions. Vous avez notamment traduit Orson Welles à la Cinémathèque française, à Paris.
Oui. Orson Welles était venu pour la cérémonie des Césars, à l’invitation de Georges Cravenne5 qui avait organisé des rencontres avec lui. Mais Welles avait dit : « Non, je ne veux pas rencontrer de journalistes. En revanche, je veux bien rencontrer des étudiants. » Il a fini par accepter une seule équipe de télé, celle de Pierre-André Boutang et Guy Seligmann. Ça s’est passé à Chaillot, en février 19826. On m’a demandé si je voulais faire le meneur de jeu. Je faisais déjà des conférences de presse à Cannes. J’ai demandé s’il voulait qu’on travaille avant, mais on m’a dit : « Non, laisse-le se reposer. » Il y avait là 1 200 étudiants et personnes, dans une salle qui en contient moins de mille.
Vous animiez aussi ou vous traduisiez seulement ses propos ?
J’animais et je traduisais en même temps. J’étais assez nerveux. Encore que, devant un tsunami, qu’est-ce qu’on peut faire ? Sa première approche a été, si je me souviens bien – j’espère que je n’embellis pas mon souvenir –, « Who here wants to be an editor? Who here wants to be a production designer? Who here wants to be an actor? Who here wants to be a producer? » À chaque fois, quelques mains se lèvent. « Who here wants to be a director? » Mille mains se lèvent. Il se penche et il fait, avec la voix la plus wellesienne du monde : « You fools7. » Et là, je me suis dit : « C’est parti. Vogue ! »
Il y avait eu une question sur la façon de traduire le mot « confused », que j’avais traduit par « désarçonné » ou « désorienté », ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel était le reste de la phrase. Et quelqu’un dans les premiers rangs m’a fait : « Non, non, c’est “confus”. » Alors, j’ai répondu : « Non. » [ton ironique] « – Si, si, si. – Non. » Et lui, il a fait : « What have we here? A debate at the Academy8. »
Finalement, le lendemain, le samedi midi de la soirée des Césars, il a accepté de recevoir des journalistes au cours d’un déjeuner, qui s’appelait le « déjeuner Welles » ou le « déjeuner Citizen Kane », avec le « soufflé des Amberson » ! On était une trentaine. Il a été brillant comme d’habitude. À la fin, tout le monde s’est jeté sur lui pour demander un autographe. Je lui en ai demandé un aussi. Et sa réponse a été délicieuse : « C’est pour vous ? – Oui. » Et comme on avait fumé comme des rats, il a fait un truc comme ça [Henri Béhar griffonne un croquis] : Henri, le micro, le cendrier, une cigarette et un cigare. « Orson. » Je l’ai donné à la Cinémathèque québécoise.
C’est au Festival de Cannes que vous avez fait vos premières armes d’interprète ?
Oui, mon premier entraînement, si j’ose dire, avait été Cannes. Ce devait être en 1972, ou quelque chose comme ça. Je faisais de la télé avec le Festival de Cannes en coproduction avec le service des relations publiques de l’ORTF. FR39 allait émettre en couleurs et voulait faire son entrée en couvrant le festival. Avec comme pitch, le fait que, jusqu’alors, on pouvait être Gloria Swanson et le président Kennedy réunis, si on ne parlait pas le français, on n’était pas interviewés à la télé française. Ils cherchaient quelqu’un qui soit assez agile dans les deux langues. Comme je m’y connaissais un peu en cinéma, ils m’ont proposé de venir. On était installés dans un studio au premier étage de l’ancien palais et on devait faire deux fois 45 minutes de direct par jour.
Je suis arrivé sur le plateau, il y avait trois caméras. « L’interview, ça va être mon problème. Vous, ça va être le visuel. Une remarque : je bouge beaucoup. Salut ! » Ça a fait marrer deux des trois cameramen. L’ un d’eux m’a dit : « Si tu bouges aussi vite que d’habitude, tu vas être flou. Alors, ralentis. » Et on a commencé avec des Losey, des Fonda, des fans de Bergman… Quelqu’un qui s’appelait Guy Allombert faisait office de maître de cérémonies, d’animateur de conférences. Pour des raisons que j’ignore, il avait dû rentrer à Paris en catastrophe. Et on m’a dit : « Guy vient de partir. Est-ce que ça t’ennuie de prendre la relève ? – Non. C’est quand ? C’est qui ? – Ah ben, c’est des Américains, c’est L’Effet des rayons gamma, Newman10. » C’était en 1973, mais le film est de 1972 et avait peut-être mis du temps de venir à Cannes. À cette époque-là, on était toujours à deux. Il n’y avait pas de traduction simultanée.
Et l’un faisait vers une langue et l’autre, vers l’autre ?
Non, l’un animait et l’autre traduisait. Et parfois, on alternait : l’un anime, les autres traduisent. Je faisais souvent équipe avec Richard Roud et Anne Head11. Anne était plus : « Tu dis ton paragraphe et je traduis le paragraphe. » Nous, c’était assez snappy [vif]. Dans les premiers temps de traduction avec Welles, c’était pareil : « Tu fais comme si j’étais un sous-titre, tu gardes ton rythme, laisse-moi juste un peu de place que je me glisse. » Sylvester Stallone avait compris parfaitement ce coup-là. Il faisait les plages. Il faisait la phrase « qui, que », « and then »…
Est-ce que vous preniez des notes ? En cas de trou de mémoire.
Non, aucune. Je traduisais en même temps, je n’avais pas le temps de prendre des notes. La sublime interprète qu’était Catherine Cadou prenait toujours des notes12. Mais parce qu’on n’interrompt pas l’empereur Kurosawa. Même quand il s’arrête, il faut faire un long blanc. Qui n’est jamais un long blanc. Qui est toujours une pause. Avec Bette Davis, ç’avait été pareil. On m’avait demandé si je voulais traduire Bette Davis à la télé, à la Cinémathèque française. J’ai dit oui, évidemment, avant même qu’on ait fini de me poser la question. Elle est arrivée à dix heures pile, comme prévu. J’avais demandé à la rencontrer la veille. Elle avait une assistante qui faisait tout, qui était tout à fait remarquable et qui m’a dit : « Non, elle va arriver demain assez tôt. Vous pourrez la rencontrer. » À dix heures, Costa-Gavras13 et moi, on l’attendait. Dix heures pile – on aurait pu régler la montre dessus –, Madame arrive. Petite comme ça. Toute petite. « Hello, I’m Bette Davis. » Ça surprend un peu, d’entrée.
Chaque fois que je voulais aborder la façon dont elle voulait que je traduise… « Pourquoi traduisez-vous pour moi ? – Parce que j’habite New York. – New York, ça n’est pas l’Amérique. – J’habite Gramercy Park. – Ah ben, Gramercy Park, c’est l’Amérique. » Et chaque fois, c’était « Later [plus tard]. » Elle voit les deux cameramen de TF1 ou d’Antenne 2, qui étaient en train de s’installer dans la salle de la Cinémathèque française à Chaillot, et leur fait un sourire de cobra. « How close do you get? No nostril shots, please14. » Elle dit à l’un d’eux : « Est-ce que je peux regarder ? » Elle va vers la caméra, puis le regarde et lui dit : « Vous êtes trop près de deux rangées. » Le plus jeune des deux grommelle : « Elle va quand même pas nous faire chier, la vieille. » L’autre l’interrompt : « Tu la fermes, tu recules, elle a inventé le cinéma. »
Moi, de temps en temps, je demande : « Comment voulez-vous que je traduise ? – Later. Why are you translating for me? » J’ai fini par dire : « Because I’m the best15. » Et elle dit : « Voilà comment ça va se passer. À onze heures et demie, on va ouvrir la porte pour laisser entrer les photographes qui opéreront pendant une demi-heure. Et puis, ils s’en iront et j’irai à la porte accueillir chacun des journalistes. » Costa et moi, on se regarde, effarés. Et je fais : « Oh, that’s not gonna work. – Oh, really? – Dès l’instant où on entrouvrira la porte, deux cents personnes vont se ruer. – We’ll see16 » Moi, je ne sais toujours pas comment ça va se passer. Elle commence et je comprends maintenant qu’elle va reprendre le show de « Conversations with Bette Davis » qu’elle avait fait aux États-Unis. Je commence à traduire – mais je ne sais toujours pas comment la traduire – dans ses respirations et elle fait : « Stop! » Je me tais, médusé. Elle enchaîne : « You see, I’m not used to sharing17. » Je m’effondre de rire sur la table, elle sourit. Et nous sommes partis. J’ai traduit au fur et à mesure.
Phrase par phrase ?
Non. Paragraphe par paragraphe. Elle me faisait des paragraphes courts, mais des paragraphes quand même. Et j’ai compris sa technique. La partie du public qui comprenait l’anglais riait à certains endroits et avec une certaine force, pour chacun des paragraphes. Elle a attendu deux ou trois paragraphes et vu que ceux qui ne parlaient que le français riaient à la même cadence et avec la même intensité. À partir de là, c’était gagné.
Le sous-titrage, avant et après l’informatisation
Revenons-en au sous-titrage. Avez-vous une méthode particulière ?
Non, mais j’ai, dans certains cas, une approche assez eastwoodienne des choses. On ne fait pas de théories, on fait. Il y a un problème, on le résout. J’ai une philosophie très basique : moins vous voyez les sous-titres, mieux je me porte. Si c’est bien fait, vous devriez avoir l’impression de parler l’anglais. L’œil doit rebondir au même rythme que l’oreille. Si, au texte, c’est un deux-morceaux, je m’efforcerai de faire un deux-morceaux en sous-titres. C’est extrêmement musical, à mes yeux. Extrêmement musical. Moins ça se voit, plus je suis content.
Vous souvenez-vous avoir dû visionner un film à sous-titrer sur une table de montage ou sur une Moritone ?
Pour les films de Woody Allen, le contact avec le ou les sous-titreurs était la chef monteuse. C’est elle, je crois, qui supervisait aussi la rédaction des transcriptions des dialogues. Chaque fois que j’avais une explication à demander, qui n’était pas dans la transcription, ou si des mots avaient été oubliés, c’est elle que j’appelais. J’ai peut-être vaguement le souvenir de voir ça sur sa table de montage, à New York.
Avant l’utilisation des ordinateurs, vous travailliez comment ?
Sur machine à écrire.
Vous n’avez jamais travaillé à la main ?
Non. Assez tôt, j’ai été pré-Microsoft, avec un système qui s’appelait le CPM et qui fonctionnait admirablement sur le Sinclair, un ordinateur anglais.
Pendant la période sous-titrage chimique, est-ce que vous vous souvenez avoir relu sur épreuves ?
Oui, on relisait sur épreuves. Barfly [Barbet Schroeder, 1987], par exemple, ç’a été relu sur épreuves.

Et une fois la copie gravée, vous ne la revoyiez pas.
Non. À cette époque-là, non.
La simulation et le travail à l’image
Avec la vidéo, l’informatique et le laser, apparaît la simulation qui n’existait pas en sous-titrage en chimique.
Non, effectivement. Ce qui est bien regrettable ! La simulation est tellement une troisième réécriture que c’est dommage de s’en priver.
Est-ce que la simulation a provoqué un changement radical dans votre façon de traduire ?
Ça dépend à quelle époque. Assez tôt d’ailleurs, mon ordinateur a été équipé du logiciel de LVT, « S titre », et après de Monal première version. Donc, j’ai fini assez vite par travailler à l’image. Ça dépendait des délais. Le plus souvent, le plus pratique, c’était de se faire envoyer le texte, que je voie dans quoi je m’engage. Je traduisais ça comme si c’était une pièce, c’est-à-dire sans souci de l’espace, du nombre de caractères, de repérage, simplement pour que je comprenne ce qu’ils disent, que je comprenne les tons : ah, attention là, il y a une plaisanterie à trois étages. Il faut donc trois étages. Même si ça n’est pas tout à fait les mêmes. L’important, c’est qu’on rie ici. Le plus près possible de, évidemment. Une fois que j’avais l’image – que j’ai eue assez tard –, je réajustais sous-titre par sous-titre.
Votre première étape, c’était donc une traduction intégrale.
Ça dépendait des conditions. Dans les périodes pré-Cannes, les films étaient prêts trois minutes avant le passage dans l’amphithéâtre Lumière. Dans l’idéal, il fallait que tout arrive en même temps, ce qui était rarement le cas. Comme je connaissais les gens de Miramax et que je travaillais à côté de chez eux, ça ne sortait pas du territoire. « Envoyez-moi le texte. – Oui, mais on est en train de travailler sur la bobine 6. On n’a pas fini le générique de fin. – Je m’en fous. Vous m’envoyez le début, au moins que je voie où c’est. – Oui, mais on n’a pas encore mis toutes les explications. » Je revoyais les choses après avec le réalisateur.
Le texte qu’on vous fournissait, c’était une spotting list18 ?
Oui. Mais il y a des différences culturelles entre le spotting américain et le spotting français. Les Américains mettent beaucoup des dialogues19. Et peu importe qu’on passe sur les changements de plan ou pas. Nous, on tâche d’éviter les dialogues. Sauf chez David Mamet. Ça va très vite. Et probablement chez Scorsese.
À la simulation, on modifiait les sous-titres en dialogue en les dédoublant. La combined continuity était souvent à réaménager. Et elle ne m’arrivait pas toujours complète, surtout quand le film était indépendant. « Donnez-moi simplement la liste des dialogues. » Je n’ai pas encore l’image, mais au moins, je sais où je vais. Qui dit quoi à qui. Mais on avait vraiment des divergences culturelles sur la façon de repérer. Je ne mets pas l’une au-dessus de l’autre. C’était comme ça.
Dès que ça a été techniquement possible, et logistiquement gérable, j’ai aussi vite que possible travaillé à l’image. Parce que, comme ça, au moins, j’avais les temps. Je demandais toujours : « N’attendez pas que les six bobines, ou les huit bobines, soient finies de repérer. Envoyez-moi bobine par bobine que je lise, que je voie où je vais. » C’était aussi l’époque où Bac Films, avec Jean Labadie, avait un contrat avec Miramax. Et Miramax était notoire dans le « Oui, oui, je t’envoie ça… » Mais comme j’étais sur place, j’insistais : « Envoyez-moi l’image, même en noir et blanc ! Donnez-moi le texte. – Oui, mais c’est pas bien écrit. – Alors, faites vérifier par le metteur en scène. Du moment que j’aie quelque chose. Même si ce n’est pas totalement complet. – Oui, bon d’accord. Tu es au coin de la rue. Ça va, je te l’envoie. »
Pour No Country for Old Men [Joel et Ethan Coen, 2007], les frères Coen m’avaient envoyé une version noir et blanc, hyper contrastée. Alors, comme tout commence par la nuit dans le désert, j’ai fini par téléphoner en disant : « Écoutez, je reconnaîtrais Tommy Lee Jones dans mon sommeil. Je connais l’accent. Mais, qui bouge où, quoi dans le désert au début ? Je ne vois rien. Vous ne pouvez pas m’envoyer ça en couleurs ? » Et ils m’ont effectivement remis une version couleur : « Surtout, ne dis rien. – Je ne dirai rien. » Tout est comme ça. Quand j’ai travaillé sur Inglourious Basterds [Quentin Tarantino, 2009], je portais le film entier sur une clé USB que j’avais autour du cou. On ne sait jamais.

Jongler avec les montages successifs
Aujourd’hui, les traducteurs sont confrontés aux montages qui ne cessent de changer jusqu’à la dernière minute. Comment gérez-vous ce type de difficultés ?
Pour Inglourious Basterds, la version sous-titrée devait être prête pour Cannes. Tarantino avait commencé par faire des séquences. Il n’a pas fait ça en bobines, mais en séquences, qui ont changé d’un montage à l’autre. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans Inglourious Basterds. Il y avait des extraits de films où Lillian Harvey chantait avec Willy Fritsch. Alors il fallait traduire la chanson de Lillian Harvey. Je vais voir comment c’était traduit à l’époque. Oui, mais à l’époque, c’était une autre version avec Henry Garat20. Finalement, on entend la chanson de Lillian Harvey, mais dans la cave, dans la bobine où tout le monde parle allemand. Mais pourquoi allait-on voir tel film avec Lillian Harvey ? Quelle était son importance aux yeux de Goebbels ? On s’en fout. Il a fait sauter ça. Alors, tout à coup, c’était : « Au fait, la séquence 17 passe entre les séquences 11 et 12, parce qu’on a changé le montage. On a resserré. »
Lorsque vous travaillez sur une version intermédiaire, pas encore mixée, devez-vous fréquemment reprendre votre traduction ?
Toujours ! Pour Menace to Society [Menace II Society, Albert et Allen Hughes, 1993] j’avais dû avoir une transcription, y compris toutes les conversations d’ambiance. Puis il y a eu le mixage et la transcription ajustée est arrivée nettement plus tard, mais j’avais quand même travaillé les 8 644 « fuck you » de la troisième passante sur le trottoir d’en face. À la guerre comme à la guerre. C’est comme ça.
Plusieurs films de front
Vous est-il arrivé de traduire plusieurs films en même temps ?
En 2002, il y a eu une période de l’année, genre novembre, décembre, où j’étais sur trois films qui étaient Chicago [Rob Marshall, 2002] dont il fallait sous-titrer les chansons, Confessions of a Dangerous Mind [2002] de George Clooney, qui s’appelle Confessions d’un homme dangereux, et The Hours [Stephen Daldry, 2002]. Chicago, c’est 1920. Confessions, c’est très précisément 1967, langage télé. Et The Hours, c’est trois périodes différentes21. J’avais trois semaines pour faire les trois. Je me levais le matin en me disant : « Je suis à quelle époque aujourd’hui ? »
Vous les avez traduits en parallèle ou l’un après l’autre ?
Il y en a un qui a mordu sur le deuxième et un poil sur le troisième. Un qui a mordu sur l’un et l’autre. Et le troisième qui s’est fini tout seul, mais c’était viable car c’est à l’intérieur du même film que ça changeait de période [The Hours]. Ça me mettait devant des choix de vocabulaire. Pour les chansons de Chicago, je ne remontais pas jusqu’à Fréhel et Damia. Ce n’était pas le ton. Mais Mistinguett était plus proche.

Pour le même festival de Cannes, j’avais traduit Grindhouse [collectif, 2007] – c’est-à-dire la partie Tarantino, « Le Boulevard de la mort » [« Death Proof »] – et No Country for Old Men. À quelqu’un qui avait vu les deux dans la même semaine, sinon dans la même journée, je demande : « Comment tu as trouvé le Tarantino ? – Ah, t’as trouvé des formules, etc. » Il était extrêmement laudateur sur le langage, entre autres parce que j’avais traduit double fucks, dit gentiment par une jeune femme à ses copines, par « les stéréoputes ». « Et le film des frères Coen, tu as trouvé ça comment ? » Il me dit : « C’était sous-titré ? » Là, j’étais aux anges. C’est le plus beau compliment que j’aie jamais reçu.
Comment vous est venue l’idée des « stéréoputes » ?
En fait, c’est très lié parce qu’on appelait les frères Coen les stereo directors. C’est en pensant à eux que j’ai traduit « stéréoputes ».
Dialoguer avec les cinéastes
Avez-vous des rapports directs avec les cinéastes, Woody Allen, Quentin Tarantino et Atom Egoyan, par exemple, dont vous avez traduit de nombreux films ?
Oui, ou avec leur équipe. Avec Woody Allen, j’en ai eu assez peu, autres que journaliste. Il me connaissait en tant que journaliste du Monde. J’étais quantité connue.
Est-ce qu’à votre avis, c’était un gage, un bon signe pour lui ?
Ah, ça n’a pas dû être un mauvais signe à cette époque-là. Il comprenait bien le français, mais ne le parlait pas particulièrement. Tout passait par sa monteuse, Susan E. Morse. On me disait : « Cette phrase-là, il y a quelque chose qui cloche. – Qu’est-ce qui cloche ? – Je ne sais pas. Quelque chose qui ne va pas. » Et, effectivement, il y avait une virgule, ou il fallait aller à la ligne ou diviser la phrase en deux. Woody Allen était imparable. Je pense que, pour 99 pour cent de ce type de remarques-là, il avait raison.
Cela tient-il aussi à un sens du montage ?
Un sens du rythme, un sens musical, je ne sais pas. Le tout à la fois ? Je me souviens sur Zelig [1983], au départ, il ne fallait pas traduire les chansons. Et puis, pour la sortie en vidéo : « Oui, oui, on traduit les chansons. » Alors, je traduis Helen Kane, très 1935, 78 tours. Et puis, il y avait une chanson – j’ai oublié qui la chantait – qui parlait de Humpty Dumpty. Et je dis : « Humpty Dumpty, en France, on ne connaît pas. Alors, quelle est l’idée de ça ? – Il faudrait que ça rime. » Bon. Résolvons le problème de comment transplanter, transférer la… Et j’ai dit : « Puisque l’idée, c’est que Humpty Dumpty tombe et se casse et ne se recolle pas en morceaux, est-ce que Jéricho22, ça marcherait ? – Well, it’s too far. I don’t know23. » Finalement, j’ai fait trois versions : une version littérale, une version Humpty Dumpty qui rimait, une version Jéricho qui rimait aussi. Silence radio. J’appelle une semaine après en disant : « Où on en est ? Vous faites quoi ? – Ah, on a pris Jéricho. »

C’est intéressant parce qu’aujourd’hui, feriez-vous la même chose ? Il y a eu une évolution de la connaissance de la langue anglaise, plus ou moins bonne selon les spectateurs, mais aussi de la culture anglaise. Est-ce que Humpty Dumpty n’est pas un peu plus parlant aujourd’hui qu’il ne l’était il y a vingt-cinq ou trente ans ?
Je ne sais pas. Harry Potter, oui. Winnie the Pooh [Winnie l’ourson], non. Winnie the Pooh est-il aussi populaire, aussi connu que Mickey Mouse ?
Parmi les cinéastes dont vous avez traduit les films, y en a-t-il que vous avez particulièrement sollicités ou, du moins, leurs maisons de production, pour sous-titrer leurs films ?
À l’époque où je travaillais avec Bac Films, mes bureaux étaient à côté de ceux de LVT à New York, qui étaient eux-mêmes à cinquante mètres de Miramax. Donc c’était beaucoup plus facile. J’ai commencé à traduire avant même que Bac ait vu le film. Mais ils savaient que ça faisait partie des quarante-cinq films du deal avec Miramax. On ne sait pas si ça sort, mais on verra bien. C’est souvent venu par les réalisateurs et les producteurs. À part Bac, ce n’est pas trop souvent venu par les distributeurs français.
Avec certains cinéastes, vous avez adopté une méthode de travail singulière.
Avec Todd Field, dont j’ai sous-titré deux films – In the Bedroom [2001] et Little Children [2006] –, le principe était simple. Que je sois à Paris, à Los Angeles, ou ailleurs, on s’enfermait dans une chambre d’hôtel pendant deux jours, avec le texte que j’avais traduit du mieux que je pouvais. Je lui renvoyais ma traduction off the cuff [au pied levé] de ce qu’était son texte, mais complètement – forcément – déformé par moi. Ce qui ne devait pas être facile pour quelqu’un qui écrit ses scénarios.

Il lisait le français ?
Pas du tout. Je lui lisais ma traduction, mais en retraduisant en anglais à partir de ce qu’était le texte français. Comme ça, il voyait en quoi ça changeait les tons, quel était l’élément d’information que, pour des raisons d’espace, je laissais tomber, si c’était important ou pas. Et, de temps en temps, il fallait vérifier telle ou telle chose, mais ça, c’est avec tout le monde.
En faisant ce retour vers l’anglais à partir de votre propre traduction et oralement, vous ne craigniez jamais de ne pas bien rendre ce que vous aviez bien traduit en français ?
Non. La règle était : je traduis sans même contrôler, comme si on était à l’ONU et que vous me parliez d’agriculture.
Et ça passait ?
Ah, avec les erreurs. Et puis, si jamais il y avait une ambiguïté, il me disait : « Ça veut dire quoi ? – Attendez. Je reviens, je le traduis un peu mieux. »
Je vous pose la question parce que j’ai aussi vécu cette expérience, ce qui n’avait vraiment pas été facile puisque j’avais l’impression de mal retraduire en anglais ce que j’avais fait correctement en français.
Oui, on retraduit en pas bien ce qui a été écrit bien. On espère.
Mais il faut se justifier assez fréquemment…
Oui, mais ça ne me gêne pas. Dans certains cas, ils comprennent l’exercice : « Tu as écrit le bon sens, mais la nuance n’y est pas : explique-moi. – Parce que je n’ai pas l’espace, parce que je déborde déjà de cinq signes ou de dix signes. D’accord, je pourrais aller jusqu’au claquement de porte, mais pas plus loin. Sinon, c’est sur deux plans. »
Avec Tim Robbins, c’était la même chose. Tim Robbins avait réalisé un premier film qui s’appelle Bob Roberts [1992]. En homme de gauche qui se respecte, il jouait un homme de droite. Et il voulait que les chansons soient traduites, mais que le disque ne sorte jamais parce que ça pouvait devenir des hymnes de la droite américaine. Mais il voulait que ce soit extrêmement précis au niveau politique. Pour ça, il a fallu que j’explique un peu plus : « Ça, c’est plus Chirac, un peu plus à droite, mais moins que Le Pen. Maintenant, est-ce que tu veux que j’aille jusqu’à Le Pen ? » Comme ça, il savait de quoi je parlais. Il fallait vérifier que l’intensité droitière soit la même qu’en anglais : « À cause de la façon dont ça se présente, j’ai préféré le dièse plutôt que le bémol. Ça te va ? » Des choses comme ça.
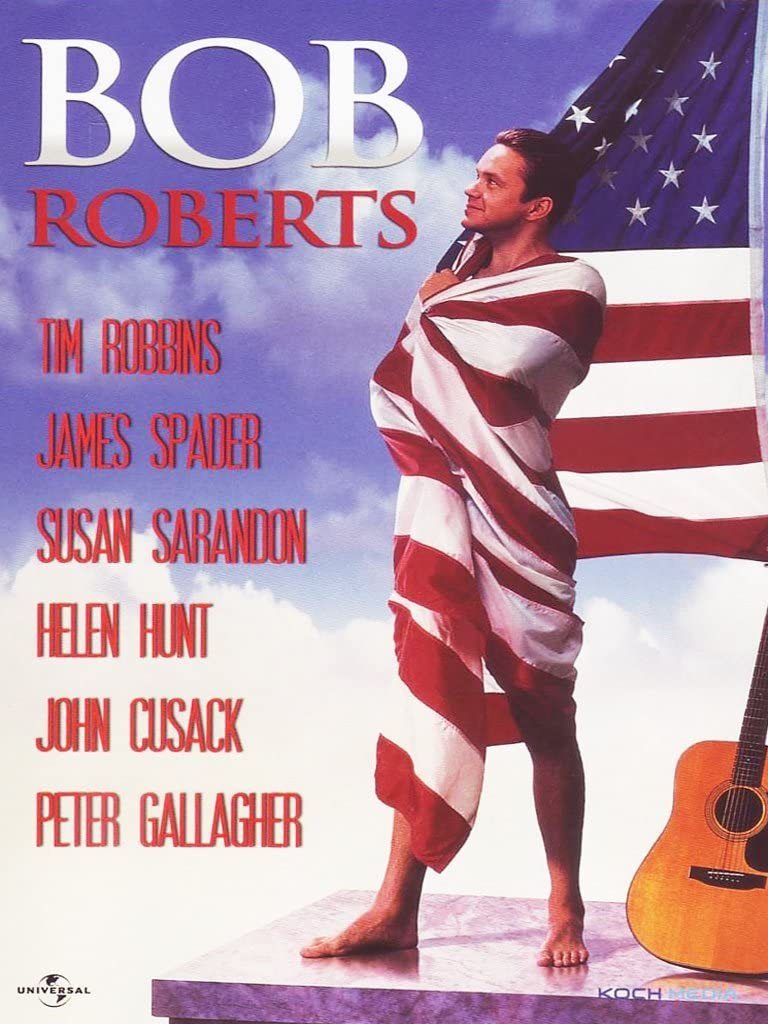
Travailler avec les cinéastes, c’est tout relire, puis commencer par corriger les fautes qu’ils n’ont pas vues quand ils ont corrigé la transcription des dialogues. Exemple : dans Little Children de Todd Field, Kate Winslet est dans un parc avec les enfants et toutes les mères qui sont là. Elle est un tout petit peu au ban. Arrive un mec avec une poussette à deux étages, si j’ose dire. Et elle fait : « Vous avez un seul enfant. » Et sa réponse est : « Yes, but it’s easier for the beer. » Je traduis donc « it’s easier for the beer ». Et il me fait : « What? – “It’s easier for the beer.” – No, no, no: “It’s easier for the bear24.” – Ah mais, tu as relu. – Oui, bon d’accord, ça m’a échappé. » Alors, on enlève la bière et on met le doudou.
Todd Field est le seul réalisateur que j’ai vu aussi actif et déterminant en simulation. Sur Little Children, il demande (il a quand même une journée entière de simu derrière lui) : « Est-ce qu’on peut démarrer le sous-titre deux images plus tard ? – OK. Ça va tenir. » Ou alors je disais : « D’accord, mais c’est serré. Est-ce qu’on peut prolonger jusqu’à la fin du soupir ? Même si la musique aura déjà commencé ? – D’accord. » À un autre moment, il fait : « Est-ce qu’on peut légèrement déplacer le sous-titre pour qu’il soit plus centré sur l’action ? » De façon assez imperceptible, le sous-titre a parfois deux millimètres de plus d’un côté ou de l’autre. Il se préoccupait du positionnement et de la découpe du sous-titre. Dans certains cas, c’était presque lui qui avait à réécrire ou à accepter une réécriture qui pouvait, toute seule, gêner à l’entournure, mais dans le flou, ne pas gêner. Ça aide, ce genre de petites choses qui passent inaperçues.
Sur Bob Roberts, Tim Robbins me dit : « Ils ont ri à tel endroit. Pourquoi ? – C’est un type d’émission littéraire qui s’appelle “Bouillon de culture”. » Et comme je n’avais pas le temps de demander l’autorisation de, je l’ai appelée « Brouillon de culture. » « That’s fine. Okay. Try25. » Sur The Cradle Will Rock [Broadway, 39e rue, 1999], il m’a demandé de renforcer un tout petit peu le côté brechtien du texte, des chansons.
Concrètement, ça consistait en quoi pour vous ?
J’ai simplement relu Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, et revu les films de Pabst, L’Opéra de quat’ sous, La Rue sans joie26, pour voir comment étaient les intertitres. Chose que j’avais aussi faite pour Kill Bill [Quentin Tarantino, 2003]. J’étais à Montréal à cette époque-là et je suis allé dans une boutique très spécialisée dans les films manga, japonais, chinois, asiatiques, kung-fu, arts martiaux et tout. Le type me voit arriver et me fait : « Si c’est pour Tigre et dragon… » J’ai dit : « Non, je veux les films asiatiques mal traduits. – Ah, plenty of them!27 »
Avez-vous été confronté à des cinéastes qui étaient satisfaits de votre traduction, mais qui souhaitaient privilégier le texte sur le repérage, sur le rythme, qui ne saisissaient pas bien les enjeux du sous-titrage ?
[silence de réflexion] À part un cas, je dirais non. La façon de leur expliquer est extrêmement simple : « Tu peux mettre la Recherche du temps perdu dans un sous-titre si tu veux. » Un seul réalisateur m’a dit : « Je me fous de l’espace. – D’accord, mais ça ne se lira pas. Donc tu y perds. Tu veux y perdre ? Ce n’est pas mon nom qui est au générique, c’est le tien. C’est ton film. »
N’est-ce pas parfois difficile de leur faire entendre raison ?
Non, je leur dis : « Ça n’est pas lu. Il y a des raisons pour lesquelles le sous-titrage a tel ou tel paramètre : c’est qu’on lit plus lentement qu’on entend. – Oui, mais alors, mettons ça sur trois lignes. – Non. Tu ne peux pas mettre ça sur trois lignes. » Dans certains cas, le metteur en scène ne m’écoute pas et fait ses sous-titres comme il veut. S’ils ne comprennent pas ça, encore une fois, c’est leur film. Moi, je peux toujours retirer mon nom du sous-titrage, si j’ai des désaccords profonds. Je me bagarre constamment pour les choix que j’ai faits, mais je rends les armes quand j’ai tort.
Avec Atom Egoyan, aviez-vous aussi besoin de faire ce travail de retraduction vers l’anglais ?
Non. Atom Egoyan parle le français, l’arabe, tout ce qu’on veut, l’arménien évidemment. Il est agile d’une langue à l’autre. Et il comprend les contraintes du sous-titrage. Lui, c’est la vraie délicatesse, plutôt que la difficulté. Avec Egoyan, il faut être extrêmement simple. Et ce n’est pas facile, la simplicité. Ça demande pas mal de relectures.
C’est une manière d’arriver à une certaine épure ?
Oui. Et comme c’est quelqu’un d’épuré – et multilingue –, il a parfois des solutions de… « Et si on essayait ça ? » Je dis : « Non, c’est trop évident. Mais il y a ça qui irait dans ta direction, qui serait plus ambigu. Tu as besoin d’ambiguïté, là. » Mais c’est aussi parce qu’on se connaît. Par les festivals. Ça facilite les choses. Il est effusif, ce n’est pas exactement quelqu’un de froid. Tout nourrit tout.
Savez-vous ce qui a l’amené à faire son livre Subtitles28 ?
Non.
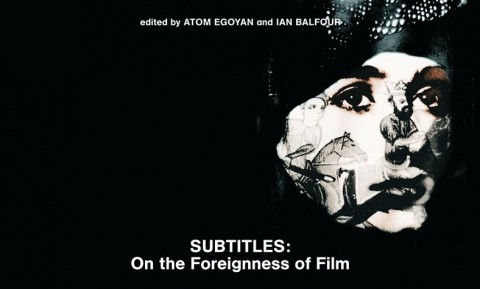
Ce n’est pas dû à votre travail ensemble ?
Non, absolument pas. Il m’a téléphoné un jour en me disant : « Je vais faire ça. Ce serait sympa que tu fasses… On va demander différents papiers à X ou Y ou Z. Y aura un papier de Ruby Rich29, des tas de gens comme ça. » C’est à Carrie Rickey30 que j’ai emprunté le titre, « The Cultural Ventriloquist31 », qui me paraissait être exactement ma mission. Je ne vois pas comment le dire autrement. C’est donc Egoyan qui m’a appelé en me disant : « Ça t’intéresserait de faire un papier sur le sous-titrage vu de l’intérieur ? – Pas de problème. »
C’est le seul texte du genre dans tout l’ouvrage, d’ailleurs.
Oui. Il est assez bien inspiré d’un papier que Carrie Rickey avait fait dans The Philadelphia Inquirer32. Mais j’apporterais une nuance maintenant. Dans Boyz N the Hood (John Singleton, 1991), quelque part dans le dialogue entre Larry Fishburne et Cuba Gooding Jr, il y a une référence à Amos ’n’ Andy33, que nous n’avons pas. Ou, du moins, que nous n’avions pas. Enfin, que je n’ai pas trouvée, que j’ai remplacée par Abbott et Costello, ce qui est une erreur. Si j’avais été plus enculturé, si j’ose dire, j’aurais dit « Foottit et Chocolat ». Mais personne n’aurait compris. Parce qu’il y a l’opposition raciale entre les deux. Avec Abbott et Costello, il n’y en a pas. Donc, j’étais à côté de la plaque. Des petites choses comme ça. Qui nécessitent de temps à autre un repeignage des sous-titres, quels qu’ils soient. À mon avis.
Dans Plenty de Fred Schepisi [1985], j’avais traduit pas mal de choses très délicates au point de vue langage. Plenty avait été écrit par David Hare. C’est assez délicat, assez précis au niveau des différentes strates de langage. Comme à une époque, j’étais le sous-titreur des films blacks, puisque personne ne savait de quoi ça retournait, j’étais aussi le sous-titreur des films très anglais. Bien qu’il soit australien. Schepisi est un metteur en scène assez futé. Il y a différents accents entre Meryl Streep, Tracey Ullman et Sting.
Avez-vous cherché à rendre les accents par des différences entre les niveaux de langue ?
J’imagine, oui. En tout cas, j’en étais conscient. Ai-je réussi à le faire ? Je n’en sais rien. Je n’ai pas relu le texte depuis quarante ans.
Continuez-vous à faire des sous-titres ?
Oui, mais j’en fais maintenant beaucoup moins. D’un, la rythmique ne me satisfait pas trop. Le numérique a un petit peu faussé les choses. De deux, la façon de faire a changé au niveau tarification. Ça marche par X dollars ou X euros la minute.
Il y a encore des distributeurs qui utilisent le tarif par sous-titre.
Moi, c’est le seul tarif que je connaissais. Si on me donne Halloween 2034 – ce que j’avais fait – à sous-titrer, il y a 600 sous-titres dont la plupart sont « Hello? Anybody there? Are you here? Who are you? Aaarrghhhh!35 » Ça, je l’ai fait en un après-midi. Mais si c’est une tarification à la minute et que c’est un film de Scorsese, il y a onze fois plus de travail.
Si la possibilité se présentait, seriez-vous prêt à reprendre certains des films que vous avez sous-titrés ?
Tous ! Pratiquement. En tout cas, je jetterais un œil à tous et il n’y aurait peut-être rien à changer. Mais il y a toujours quelque chose à changer. Toujours.
Propos recueillis les 26 avril et 7 juin 2017 à Paris par Jean-François Cornu, révisés par Henri Béhar le 11 décembre 2020.
Filmographie sélective des films anglophones sous-titrés en français par Henri Béhar (par ordre alphabétique des noms de réalisateur et réalisatrice)
Woody Allen : Zelig (1983), Broadway Danny Rose (1984), La Rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo, 1985, révision), Hannah et ses sœurs (Hannah and Her Sisters, 1986, révision), Radio Days (1987), September (1987), Une autre femme (Another Woman, 1988), Crimes et délits (Crimes and Misdemeanors, 1989), New York Stories (coréal. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, 1989)
Gregg Araki : Mysterious Skin (2004)
Denys Arcand : Stardom (2000)
Noah Baumbach : Margot va au mariage (Margot at the Wedding, 2007)
Ken Burns : Jazz (2001, série documentaire)
Jane Campion : Holy Smoke (1999)
Nick Cassavetes : She’s So Lovely (1997)
Derek Cianfrance : Blue Valentine (2010), The Place Beyond the Pines (2012)
Larry Clark : Kids (1995), Bully (2001)
George Clooney : Confessions d’un homme dangereux (Confessions of a Dangerous Mind, 2002)
Joel & Ethan Coen : No Country for Old Men (2007)
Michael Corrente : American Buffalo (1996)
Stephen Daldry : The Hours (2002)
Jonathan Demme : Dangereuse sous tous rapports (Something Wild, 1986)
Robert Duvall : Le Prédicateur (The Apostle, 1997)
Atom Egoyan : Exotica (1994), De beaux lendemains (The Sweet Hereafter, 1997), Le Voyage de Felicia (Felicia’s Journey, 1999), Ararat (2002), La Vérité nue (Where the Truth Lies, 2005), La Citadelle (Citadel, 2006, documentaire), Adoration (2008)
Stephan Elliott : Priscilla, folle du désert (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1994)
Todd Field : In the Bedroom (2001), Little Children (2006)
Terry Gilliam : Las Vegas parano (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998)
James Gray : The Yards (2000)
Peter Greenaway : The Tulse Luper Suitcases, part 1: The Moab Story (2003)
David Wark Griffith : Intolérance (Intolerance, 1916, film muet, intertitres)
Lasse Hallström : L’œuvre de Dieu, la part du diable (The Cider House Rules, 1999), Chocolat (2000), Une vie inachevée (An Unfinished Life, 2005)
Michael Haneke : Funny Games U. S. (Funny Games, 2007)
Allen & Albert Hughes : Menace to Society (Menace II Society, 1993)
Peter Jackson : Créatures célestes (Heavenly Creatures, 1994)
Steve James : Roger Ebert: Life Itself (2014, documentaire)
Stan Lathan & Harry Belafonte : Beat Street (1984)
Ang Lee : Chevauchée avec le diable (Ride With the Devil, 1999), Le Secret de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain, 2005), Hôtel Woodstock (Taking Woodstock, 2009)
Spike Lee : Summer of Sam (1999)
Richard Lester : Quatre garçons dans le vent (A Hard Day’s Night, 1964)
Richard Linklater : Fast Food Nation (2006)
John Madden : Shakespeare in Love (1998), Proof (2005)
Rob Marshall : Chicago (2002, dialogue et chansons)
Anthony Minghella : Retour à Cold Mountain (Cold Mountain, 2003)
Sally Potter : Yes (2004)
Tim Robbins : Bob Roberts (1992, dialogue et chansons), Broadway, 39e rue (Cradle Will Rock, 1999)
Robert Rodriguez : Spy Kids (2001), Mission 3D : Spy Kids 3 (Spy Kids 3: Game Over, 2003), Planète terreur (Planet Terror, 2007)
Patricia Rozema : Mansfield Park (1999)
John Sayles : Le Secret de Roan Inish (The Secret of Roan Inish, 1994)
Fred Schepisi : Plenty (1985)
Julian Schnabel : Basquiat (1996), Avant que la nuit tombe (Before Night Falls, 2000)
Paul Schrader : Étrange Séduction (The Comfort of Strangers, 1990), Adam Resurrected (2008)
Barbet Schroeder : Barfly (1987)
Ridley Scott : Robin des bois (Robin Hood, 2010)
Susan Seidelman : Cherche Susan désespérément (Desperately Seeking Susan, 1985)
John Singleton : Boyz N the Hood, la loi de la rue (Boyz N the Hood, 1991)
Kevin Smith : Dogma (1999), Jay et Bob contre-attaquent (Jay and Silent Bob Strike Back, 2001), Clerks II (2006)
Todd Solondz : Happiness (1998), Life During Wartime (2009)
Quentin Tarantino : Kill Bill, volume I (Kill Bill: vol. 1, 2003), Kill Bill, volume II (Kill Bill: vol. 2, 2004), Boulevard de la mort (Death Proof, partie de Grindhouse, coréal. Robert Rodriguez, 2007), Inglourious Basterds (2009), Django Unchained (2012), Once Upon a Time… in Hollywood (2019)
James Toback : Tyson (2008, documentaire), Seduced and Abandoned (2013, documentaire)
John Turturro : Mac (1992), Illuminata (1998)
Gus Van Sant : Drugstore Cowboy (1989), Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)
Keenen Ivory Wayans : Scary Movie (2000), Scary Movie 2 (2001)
Orson Welles : Othello (The Tragedy of Othello, 1952, version dite restaurée en 1992)
Marina Zenovich : Roman Polanski: Wanted and Desired (2008, documentaire)
David Zucker : Scary Movie 3 (2000)
