Les deux sous-titrages américains du Château de l’araignée
En 2003, l’éditeur de DVD américain Criterion publiait une nouvelle édition du Château de l’araignée d’Akira Kurosawa (Kumonosu-jo, en anglais Throne of Blood, 1957) accompagnée de bonus inattendus1 :
« - Deux sous-titrages différents, réalisés respectivement par Linda Hoaglund et par Donald Richie, traducteurs mondialement réputés de films japonais
- Des notes sur le sous-titrage, par Linda Hoaglund et Donald Richie.2 »
En effet, le menu du DVD met en avant ce choix dans la rubrique « Sous-titres » en identifiant chaque sous-titrage par le nom de son auteur. Pour mieux les distinguer, l’éditeur a en outre choisi d’attribuer une police différente à chacune des deux versions.
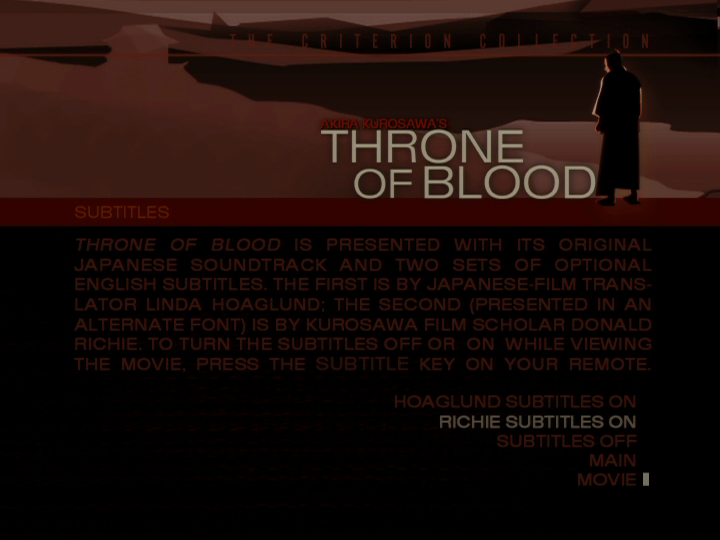

À l’intérieur du livret d’une dizaine de pages accompagnant le DVD, on peut lire, en guise d’introduction à ces « Notes sur le sous-titrage des films japonais » :
« Le Château de l’araignée représente un défi particulier pour l’auteur de ses sous-titres, qui doit non seulement restituer la langue du film de façon aussi concise que possible, mais aussi tenir compte de la forme très codifiée du texte shakespearien dont s’inspirent les dialogues, tout en transposant l’interprétation personnelle que donne Kurosawa d’un parler d’époque. Afin de mettre en avant le caractère subjectif de l’art de sous-titrer, Criterion propose ici deux sous-titrages, réalisés chacun par un traducteur mondialement réputé de films japonais. Dans les textes qui suivent, Linda Hoaglund et Donald Richie relatent comment ils ont abordé cette œuvre singulière. »
Cette initiative rare est intéressante, d’abord parce qu’elle présente deux sous-titrages au parti pris marqué, immédiatement reconnaissables, ce qui confirme s’il le fallait le caractère unique de toute adaptation audiovisuelle. Intéressante aussi parce que cette parole donnée aux traducteurs enrichit la lecture de l’œuvre de Kurosawa ; de quoi donner, peut-être, des idées de bonus à d’autres éditeurs de DVD3…
Il faut dire que les deux « traducteurs mondialement réputés de films japonais » ne sont pas les premiers venus. Linda Hoaglund, productrice et réalisatrice, a sous-titré depuis le milieu des années 1990 quelque 200 films japonais4. Quant à Donald Richie, décédé en 2013, il a signé de très nombreux ouvrages sur la société et le cinéma japonais5.
Nous remercions Criterion d’avoir autorisé L’Écran traduit à reproduire ces textes dans une traduction en français d’Anne-Lise Weidmann.
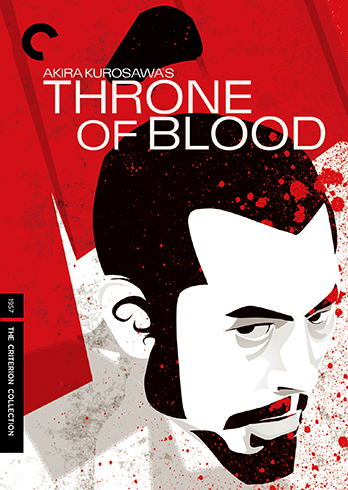
Linda Hoaglund
Lorsque Criterion m’a demandé de réaliser de nouveaux sous-titrages pour sept classiques de Kurosawa Akira (Les Sept Samouraïs, Vivre, Le Château de l’araignée, Chien enragé, Les Salauds dorment en paix, L’Ange ivre et Vivre dans la peur6), je savais que Le Château de l’araignée représenterait le plus grand défi. Infusés dans un épais mélange poético-métaphorique, les dialogues du film sont aussi âpres et stylisés que les plans saisissants qui défilent à l’écran. Et si, dans Les Sept Samouraïs, les échanges sont agrémentés de formules et de gestes anachroniques, clins d’œil à une sensibilité plus contemporaine, ils en sont totalement dépourvus dans Le Château de l’araignée. Tout, dans ce film, et surtout sa langue, renvoie à un Japon médiéval maintenu dans un chaos permanent par les intrigues des seigneurs de guerre rivaux.
Pour moi, la démarche consistant à traduire et à condenser en anglais des dialogues japonais est organique et viscérale. Je perçois les émotions du personnage en japonais et les exprime en anglais, alors même que ces deux langues ne sauraient être plus différentes. Les Américains jugent les expressions japonaises vagues ; les Japonais trouvent l’anglais impitoyablement précis. Le japonais se passe généralement de sujet et les temps verbaux y suivent une logique bien à eux. Il arrive que plusieurs phrases s’enchaînent sans jamais mentionner le genre d’un sujet ou qu’un même paragraphe mêle des temps qui se contredisent. Les interactions en société sont présumées suffisamment transparentes pour pouvoir se passer de références linguistiques qui sont fondamentales en Occident. Savoir ce que pense son interlocuteur autorise à être laconique. La forme infinitive du verbe « aller » constitue une phrase à elle toute seule, qui peut signifier selon le cas « j’irai », « nous irons », « ils iront », « irai-je ? », « iras-tu ? » ou « iront-ils ? ».
Fille de missionnaires américains progressistes, j’ai été élevée dans le Japon rural où je fréquentais l’école japonaise. J’ai ainsi grandi en habitant deux langues. Mes parents, qui souhaitaient que nous bénéficiions d’une éducation bilingue, nous enseignaient l’anglais aux petites heures du jour. Le soir au dîner, nous racontions en anglais notre journée à l’école japonaise et, au moindre mot prononcé en japonais, il nous fallait glisser un yen dans la tirelire familiale. Dans le peu de temps que nous avions le droit de consacrer à la télévision, nous regardions des séries de samouraïs et des séries policières japonaises (l’une de mes préférées était Key Hunter, dont Fukasaku Kinji a réalisé les premiers épisodes). Grâce à cette enfance atypique, je dispose semble-t-il de deux cerveaux distincts mais parallèles qui me permettent d’entendre dans une langue et de comprendre dans l’autre. Lorsque je sous-titre des films, j’efface les obstacles à la compréhension des échanges en japonais, afin de mettre en avant les composantes humaines et universellement accessibles de ces derniers. Pour ce faire, je me concentre sur la substantifique moelle des personnages et de leurs échanges, en « réécrivant » ces derniers en anglais.
Le Château de l’araignée est la géniale adaptation de Macbeth réalisée par Kurosawa. Le scénario est clairement inspiré de la « pièce écossaise7 » de Shakespeare, mais à en croire Nogami Teruyo, scripte du film, le cinéaste ne s’est jamais référé au texte de l’œuvre pour construire son adaptation, qui épouse les conventions du théâtre nô. Au contraire, il en a repensé l’intrigue en l’incorporant aux traditions linguistiques et théâtrales propres au Japon. Afin de ne pas me laisser influencer dans mes choix linguistiques, je me suis également abstenue de consulter le texte de Shakespeare lors de mon travail préparatoire à la traduction du film. Avec ma réviseuse, Judith Aley, je me suis plutôt attachée à trouver des termes archaïques qui atténuent tout réalisme et renforcent la théâtralité formelle du film, comme le font les dialogues originaux de Kurosawa. Nous avons ainsi retenu « slay » [occire] plutôt que « kill » [tuer], « hovel » [masure] plutôt que « shack » [cabane, taudis], « valiant » [vaillant] plutôt que « brave » [courageux], etc. La langue façonne une personnalité. Chaque personnage a de nombreux tics de langage révélateurs. Dans Le Château de l’araignée, l’élégance suave d’Asaji (la Lady Macbeth du film) rend d’autant plus inquiétante son insondable perfidie :
« Great Lord is a fox. With easy words, he cheats you (out) of the North Garrison, sends his trusted Miki out of danger to guard Spider’s Web Castle, and casts you, his most hated adversary, into danger. From the heights of the castle keep, Miki will laugh as he watches you take your last gullible breath. »
[Le Grand Seigneur est rusé. Avec ses belles paroles, il vous dépouille de la Citadelle du Nord, met hors de danger Miki, en qui il a confiance, en l’envoyant garder le Château de l’araignée et vous expose au danger, vous, son adversaire abhorré. Du haut du donjon du château, Miki vous regardera en riant rendre votre dernier souffle crédule8.]
Lorsque je compose des tempéraments et que je donne une tonalité au film, a fortiori si je dois faire passer de l’humour, je m’écarte sans vergogne de toute traduction littérale. Mon objectif est de faire en sorte que l’œuvre produise sur les spectateurs anglophones exactement le même effet que sur le public japonais, et non d’empêtrer un public occidental dans les subtilités d’une tradition qu’il maîtrise mal.
Je dois une reconnaissance éternelle à ma réviseuse, Judith Aley, qui peaufine scrupuleusement mes premiers jets encore imprégnés, bien souvent, d’un léger parfum de japonais, ou parsemés d’aphorismes anglais comiques à force d’être nébuleux. Nous nous efforçons de mettre le public occidental à l’aise par nos choix de mots. Nous voulons que les spectateurs américains se sentent à la fois suffisamment intrigués et en confiance pour s’immerger dans l’œuvre et tisser des liens affectifs avec les personnages, afin qu’ils profitent pleinement du film. Après tout, n’est-ce pas pour cela que nous aimons le cinéma ?
Donald Richie
Toute traduction est un compromis, mais aucune forme de traduction ne l’est sans doute aussi foncièrement que le sous-titrage de films. Disposant d’un espace restreint, le traducteur est censé y restituer à l’écrit des dialogues parlés sans excéder la durée de leur énonciation. Une tâche impossible.
Cette impossibilité s’explique par les modalités pratiques de ce type de traduction. Pour parvenir à cette copie imparfaite de l’original, le traducteur part d’un relevé écrit des dialogues et d’une liste indiquant la longueur des répliques. Cette dernière est exprimée en pieds : un pied donne droit à un ou deux mots ; six pieds correspondent grosso modo à une phrase entière9.
Toute réplique d’une longueur supérieure doit être divisée en segments plus courts, l’espace réservé aux dialogues à l’écran étant limité à deux lignes pleines au bas de l’image, soit environ douze pieds en tout. Plus volumineux, les sous-titres dénatureraient l’image.
Le nombre de mots autorisé dépend toutefois du spectateur. Le traducteur anglais ou américain lit naturellement plus vite que l’employé de la société de production japonaise qui inspecte les travaux finis. Celui-ci soutient souvent que les sous-titres comptent trop de mots et que la règle – pour un Japonais – veut qu’on ait le temps de les lire deux fois. En suivant ce principe à la lettre, on ne pourrait restituer qu’une faible proportion des dialogues dans les sous-titres.
La grande préoccupation du traducteur, cependant, concerne non pas les sous-titres longs, mais les plus courts. Un personnage qui parle vite peut prononcer jusqu’à huit syllabes resserrées. Prenons l’exemple de « Mo dekakerukana ? », que l’on pourrait traduire par « Shall we go then? » [Alors, on y va ?]. Cette solution excède légèrement la quantité de texte autorisée pour un pied et sacrifie quelques nuances, mais c’est probablement celle que je retiendrais, du moins si on me le permettait. Toutefois, la plupart des traducteurs du japonais (et la grande majorité des films exportés par le Japon sont sous-titrés par des Japonais, sans contrôle par un locuteur natif) se contenteraient de « We go? » [On va ?] ou même de « Go? ».
S’il est déjà difficile de retranscrire l’oralité dans ce mode de communication sous contrainte, il est plus ardu encore de restituer le ton du locuteur. C’est pourtant une nécessité et voici comment je m’y emploie.
Pour réaliser un sous-titrage, je travaille toujours avec un « traducteur-relais », généralement un Japonais. Je pars en effet d’une transcription, or ma maîtrise de la langue écrite est trop imparfaite pour me mettre à l’abri des erreurs.
Après plusieurs visionnages du film, je divise les dialogues en segments, en m’appuyant à la fois sur la traduction relais et sur le repérage. Ce premier découpage étant fait, je visionne le film une nouvelle fois, avec le premier jet de la traduction sous les yeux.
C’est à ce stade qu’il me faut tenter de rendre le ton des personnages dans les répliques. Cette opération est généralement difficile. Il n’existe aucun équivalent, en anglais, des multiples degrés de déférence du japonais ; les moyens d’exprimer les différences de registre selon le sexe du locuteur sont limités ; aucune convention ne permet de désigner un personnage par son rang (oniisan et aniki sont tous deux rendus par « elder brother » [frère aîné]) ; enfin, l’omission du pronom personnel ne fait pas partie des usages. Il est cependant possible de restituer la plupart de ces effets grâce à des formes et des termes approchants.
Lorsque je travaille sur le sens et le ton, mon idéal est un anglais standard et fluide. En conséquence, je veille à n’amplifier aucun effet. J’ai même plutôt tendance à assagir les dialogues pour atténuer l’émotion de certaines scènes. Pas de mots surchargés de sens, pas de formules alambiquées et aucune sensiblerie dans mes sous-titres.
En effet, la traduction doit selon moi être invisible. Elle n’est qu’une convention, à l’instar de la taille de l’écran, du noir et blanc ou de la couleur. Une fois sa présence entérinée, nul besoin de continuer à la souligner ; cela ne pourrait que distraire le spectateur du film proprement dit.
Dans un sous-titrage, une bizarrerie, un terme trop accentué ou une erreur attire immédiatement l’attention sur les dialogues écrits, ce qui est dommageable à mon sens. Je n’utilise même pas de points d’exclamation. La langue doit pénétrer dans l’oreille comme l’image dans les yeux.
C’est la raison pour laquelle je m’efforce d’employer un anglais parlé, mais purgé de son argot et respectant scrupuleusement les différents usages des mots selon les époques. Dans le même temps, je cherche à créer une langue rigoureusement neutre. Faute d’y parvenir, j’anéantirais moi-même l’illusion qu’il m’incombe d’entretenir.
Cela m’est arrivé avec les sous-titres de Ran de Kurosawa Akira. Grisé par cette reconstitution à grand spectacle, j’ai baissé la garde et cru bon d’introduire une touche de « couleur historique » de mon cru. Pas question, cela va de soi, d’employer des expressions telles que « s’blood » [palsambleu] ou « by my oath » [sur ma foi], dont se serait pourtant bien accommodée la langue théâtrale des dialogues, typique des jidai-geki (films historiques). Il s’agissait plutôt d’omettre par endroits des prépositions, procédé courant dans l’anglais cérémonieux parlé à la cour. Pour dire « Je veux que tu t’en ailles », j’ai ainsi sottement écrit « I would wish you go » au lieu d’un simple « I want you to go ». Ce n’est pas incorrect, mais complètement déplacé dans des sous-titres. En conséquence, les spectateurs anglophones ont cru que la traduction était truffée d’erreurs et avait été réalisée par un Japonais.
Il m’arrive d’appuyer un effet avec un résultat satisfaisant, mais uniquement lorsque le film use lui-même d’exagération. Ainsi, si l’œuvre manque de naturel, l’artificialité supplémentaire des sous-titres devient une convention qui, dès lors qu’elle est établie d’emblée, ne perturbe pas le spectateur et alimente l’illusion au lieu de la mettre à mal.
Pour sous-titrer Le Château de l’araignée, un film dont l’esthétique est tellement stylisée que son chef décorateur a dû inventer tout un style architectural « historique » pour l’occasion, j’ai opté pour un langage appuyé, pensant qu’il servirait l’artificialité visée par Kurosawa, voire y contribuerait. J’ai lu les auteurs mineurs du théâtre jacobéen – Francis Beaumont, John Fletcher, John Webster, Cyril Tourneur – et notamment des pièces telles que La Tragédie du vengeur10, jusqu’à ce que j’aie bien assimilé leur emphase sanguinaire. C’est cela que j’ai tenté de recréer dans mes sous-titres.
Si la transparence est un noble idéal, l’opacité a aussi ses mérites. Tout dépend de l’œuvre à traduire. Il m’a semblé qu’un style éloigné du langage familier, nécessitant un temps de réflexion de la part du spectateur, servirait ce film si oppressant, aux personnages cernés de toutes parts. J’espérais que mes mots endigueraient les émotions, comme le faisait la dramaturgie du film.
Voilà le pourquoi de ma petite expérience jacobéenne. J’ignore si le résultat est heureux ou non, car ces sous-titres n’ont jamais été utilisés et n’ont encore été vus par personne. Le distributeur qui les avait commandés a en définitive décidé d’employer les sous-titres originaux des studios de production Toho, réalisés en interne.
Plus tard, lorsque j’ai adapté La Vengeance d’un acteur (Yukinojo Henge, Ichikawa Kon, 1963), un film sur les débuts du kabuki, au style visuel ostensiblement marqué, il m’a semblé que l’œuvre s’accommoderait de sous-titres tout aussi ostensibles. Ayant trouvé un pendant de l’époque dépeinte dans le film, je me suis plongé dans les œuvres de William Congreve et de John Dryden et n’ai commencé à travailler sur les dialogues qu’une fois suffisamment imprégné des rythmes du théâtre de la Restauration anglaise11. En l’espèce, mes efforts ont porté leurs fruits et ont, je crois, permis aux spectateurs de langue anglaise d’apprécier l’œuvre.
Cependant, de nombreuses différences culturelles séparent le Japon et les États-Unis, posant parfois des problèmes quasi insolubles. En sous-titrant Rhapsodie en août (Hachigatsu no kyoshikyoku, Kurosawa Akira, 1991), je me suis ainsi heurté au mot « kappa ». Les dictionnaires s’obstinent à le traduire par « water imp » [diablotin, lutin des eaux], mais un terme aussi désuet me semblait délicat dans le contexte de ce film. Même utilisé comme adjectif, « imp » est en passe de devenir obsolète dans les pays de langue anglaise. Rhapsodie en août s’attache en outre aux attributs malveillants de la créature et non simplement à son espièglerie. J’ai opté pour « water demon » [démon des eaux], afin d’expliquer le caractère humide du personnage et le comportement des enfants, mais je n’en suis pas pleinement satisfait. Bien souvent, il n’existe pas d’équivalent idoine.
Il va de soi que le problème se pose aussi dans l’autre sens et que le traducteur japonais doit souffrir tout autant pour se dépêtrer de l’intransigeance de l’anglais. Trop souvent, il résout les difficultés au moyen d’une « katai honyaku » – une traduction littérale de dictionnaire – sans se préoccuper du personnage, du ton, de l’intention ou de tout autre paramètre.
Les sous-titres japonais de Too Much ! (Wish You Were Here, David Leland, 1987), un film britannique aux dialogues truffés d’argot, offrent ainsi l’un des cocktails d’ignorance, de bâclage et de katai honyaku les plus spectaculaires de ces dernières années. Parmi les bizarreries qui en résultent figure la traduction du mot « bugger », utilisé à tout bout de champ par la jeune héroïne, mais uniquement dans son acception actuelle et sous forme de nom : un bon à rien, un idiot.
Perplexe, le traducteur japonais a cherché le mot dans son dictionnaire et n’y a trouvé qu’une définition. Parmi les quelques synonymes japonais proposés, il a retenu « okama », qui désigne généralement un homosexuel passif et travesti. Les spectateurs ont donc découvert avec effarement les nombreuses scènes dans lesquelles l’héroïne au parler fleuri, chevauchée par de robustes mâles pleins d’ardeur, leur hurlait des « okama » à répétition.
Le sous-titrage étant un art difficile, on peut faire preuve de compréhension face à ces accommodements grotesques, sans pour autant les approuver. En outre, nul n’étant à l’abri d’une baisse de vigilance, qui sait si ma prochaine traduction ne se soldera pas par un ratage du même genre ? Les contraintes de temps et d’espace interdisent la nuance et les simplifications fautives sont omniprésentes.
Sans doute faut-il envisager cette entreprise non pas en déplorant ce que l’on perd, mais en s’émerveillant de ce que l’on parvient à faire passer.
